Introduction
Retrouvez ici les synthèses des cours, mes documents de préparation de cours, les liens des vidéos support, les ressources annexes étudiées.
Programme de 3ème
Le programme d'histoire en 3ème s'articule autour de ces trois thèmes:
- Thème 1 - L’Europe, un théâtre majeur des guerres totales (1914-1945) : L'Europe, au cœur des deux guerres mondiales du XXe siècle, a été le théâtre de bouleversements majeurs qui ont façonné l'histoire contemporaine. Entre 1914 et 1945, les conflits mondiaux ont transformé le continent en un champ de bataille où les enjeux politiques, idéologiques et territoriaux ont radicalement redéfini les rapports internationaux et les sociétés européennes.
- Thème 2 : Le monde depuis 1945 : Depuis 1945, le monde a connu des transformations majeures, marquées par la guerre froide, la décolonisation, la mondialisation et l'émergence de nouveaux enjeux sociaux et géopolitiques.
- Thème 3 : Françaises et Français dans une République repensée : Dans un contexte où la République se redéfinit à travers ses valeurs et ses institutions, il est essentiel de se pencher sur la place et le rôle des Françaises et des Français, acteurs essentiels de cette transformation.
Les Cours
Thème 1 - L’Europe, un théâtre majeur des guerres totales (1914-1945)
----------------MODELE-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chapitre 1 : La Première Guerre Mondiale
L’Europe à la veille de la première guerre mondiale
Juste avant la Première Guerre mondiale, l'Europe est une région complexe et tendue, marquée par des rivalités nationales, des alliances militaires, et des tensions politiques.
Contexte Politique
L'Europe est dominée par plusieurs grandes puissances :
l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, la Russie, la France et la
Grande-Bretagne. Ces pays sont liés par des alliances militaires
complexes, notamment la Triple Alliance (Allemagne,
Autriche-Hongrie, Italie) et la Triple Entente (France, Russie,
Grande-Bretagne).
Ces alliances visent à maintenir un équilibre des pouvoirs, mais
elles contribuent également à polariser le continent.
Nationalismes et Rivalités
Le nationalisme est en pleine expansion, avec des mouvements
qui cherchent à unir ou à séparer certains peuples en fonction
de leur identité nationale. Les Balkans sont une région
particulièrement instable, avec des conflits entre les
différents peuples et les ambitions des grandes puissances.
La montée en puissance de l'Allemagne, devenue une nation
unifiée en 1871, inquiète la France et la Grande-Bretagne,
tandis que la Russie soutient les Slaves des Balkans contre
l'Autriche-Hongrie.
Course aux Armements
Les puissances européennes sont engagées dans une course aux armements, cherchant à renforcer leurs forces militaires en vue d'une guerre potentielle. Les tensions sont exacerbées par la militarisation croissante, avec des plans de guerre élaborés à l'avance, comme le plan Schlieffen de l'Allemagne pour envahir la France en cas de conflit.
Impérialisme et Colonies
Les rivalités coloniales augmentent les tensions. Les
puissances européennes possèdent de vastes empires coloniaux en
Afrique et en Asie, et la compétition pour le contrôle de ces
territoires crée des frictions supplémentaires.
L'Allemagne, en particulier, cherche à étendre son empire
colonial, ce qui la met en conflit avec la Grande-Bretagne et la
France.
Situation Économique et Sociale L'Europe connaît une grande
prospérité économique, avec une industrialisation rapide, en
particulier en Allemagne et au Royaume-Uni. Cependant, les
disparités sociales et les conditions de travail difficiles pour
les classes ouvrières créent des tensions internes, tandis que
le mouvement ouvrier et les idées socialistes gagnent en
influence.
En résumé, à la veille de la Première Guerre mondiale, l'Europe
est un continent en paix apparente, mais sous la surface, des
rivalités nationales, des alliances militaires rigides, des
ambitions impérialistes, et des tensions sociales créent un
climat explosif, prêt à s'embraser au moindre incident.
La Première Guerre mondiale, qui a eu lieu de 1914 à 1918, fut
un conflit majeur impliquant de nombreux pays. Elle a opposé
principalement les Alliés (France, Royaume-Uni, Russie,
États-Unis) aux puissances allemandes et hostro-hongroises.
----------------YOUTUBE-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mots clefs
Tensions entre les pays européens
Les rivalités politiques, économiques et militaires qui ont
exacerbé les conflits d’intérêts entre grandes puissances.
Rivalités et alliances
Les jeux d’influences et de compétitions entre nations.
Nationalisme
Le sentiment d’appartenance intense à une nation, qui alimente
à la fois les revendications d’indépendance et les conflits
entre les Etats.
Les causes de la guerre
La guerre a commencé après l'assassinat de l'archiduc François-Ferdinand d'Autriche en juin 1914, mais elle est aussi le résultat de tensions entre les pays européens. Ces tensions étaient dues à des rivalités, des alliances, et un nationalisme fort. L’assassinat a servi de déclencheur pour l’escalade du conflit.
----------------YOUTUBE-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La guerre de mouvement (1914)
Au début de la guerre, en 1914, les combats sont marqués par
une guerre de mouvement. Les armées se déplacent rapidement,
avec des offensives et des contre-offensives. Les principaux
fronts sont : Le front occidental : Après le déclenchement des
hostilités, l'Allemagne lance une offensive rapide contre la
France en passant par la Belgique (plan Schlieffen). Cependant,
l’armée allemande est stoppée à la bataille de la Marne
(septembre 1914), ce qui empêche la prise rapide de Paris.
Le front oriental : En parallèle, l’Allemagne et
l’Autriche-Hongrie affrontent la Russie, avec des avancées
initiales sur le territoire russe. La guerre est plus mobile sur
ce front, avec des batailles plus étendues et moins de
tranchées.
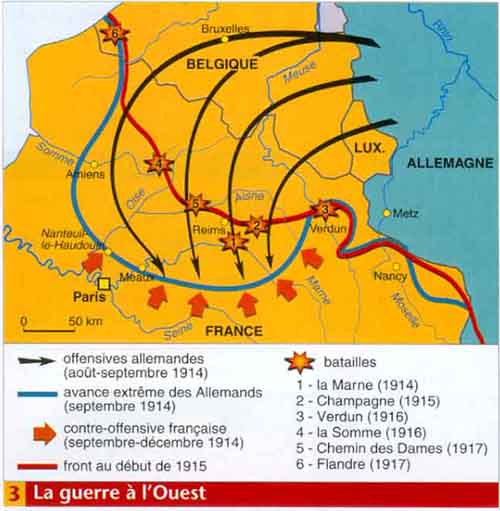
La guerre de position (1915-1917)
À partir de 1915, le front occidental, notamment, entre dans
une phase de guerre de position. Les armées s’enterrent dans des
tranchées, et les lignes de front se stabilisent, ne bougeant
presque pas pendant plusieurs années.
Front occidental : La guerre de position est symbolisée par la
construction de milliers de kilomètres de tranchées,
principalement en France et en Belgique. Les combats deviennent
extrêmement meurtriers et épuisants, avec des batailles comme
celles de Verdun (1916) et de la Somme (1916), où des milliers
de soldats tombent pour gagner quelques mètres de terrain.
Front oriental : Bien que plus mobile, le front de l'Est entre
l’Allemagne, l’Autriche-Hongrie et la Russie reste également
marqué par des phases de position, avec des lignes qui fluctuent
en fonction des victoires et défaites.
Mots clefs
Guerre de mouvement (1914)
Une phase initiale de la guerre caractérisée par des
déplacements rapides des armées et des offensives successives.
Plan Schlieffen
La stratégie militaire allemande visant à vaincre rapidement
la France en passant par la Belgique, qui a influencé le
déroulement des combats sur le front occidental.
Front occidental
La zone de conflit principale en Europe de l’Ouest, notamment
en France et en Belgique, où s’est opposée l’armée allemande
aux forces alliées.
Front oriental
La zone de combat où se sont affrontées l’Allemagne,
l’Autriche-Hongrie et la Russie, caractérisée par une plus
grande mobilité.
Guerre de position (1915-1917)
Une phase marquée par l’enlisement des combats dans des
tranchées, où les lignes de front se stabilisent pour des
périodes prolongées.
La Bataille de Verdun
La bataille de Verdun (21 février - 18 décembre 1916) est
l’une des batailles les plus emblématiques et dévastatrices de
la Première Guerre mondiale. Elle opposa principalement
l’armée française à l’armée allemande dans le nord-est de la
France, près de la ville fortifiée de Verdun. L’objectif de
l’Allemagne, sous la direction du général von Falkenhayn,
était de “saigner à blanc” l’armée française en attaquant un
point hautement symbolique pour les Français.
Verdun avait une valeur stratégique en raison de ses
fortifications, mais surtout une importance morale. La bataille
fut marquée par une guerre d’usure, avec des combats incessants
dans des conditions terribles. Les forces françaises, sous le
commandement du général Pétain, réussirent à tenir malgré
de lourdes pertes, grâce notamment à la “Voie sacrée”, une
route cruciale pour le ravitaillement en hommes et en matériel.
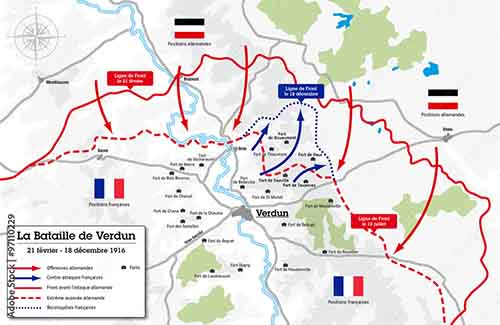
Après près de 10 mois de combats, les Français réussirent à
repousser les Allemands, mais les pertes furent énormes :
environ 300 000 morts et des centaines de milliers de blessés.

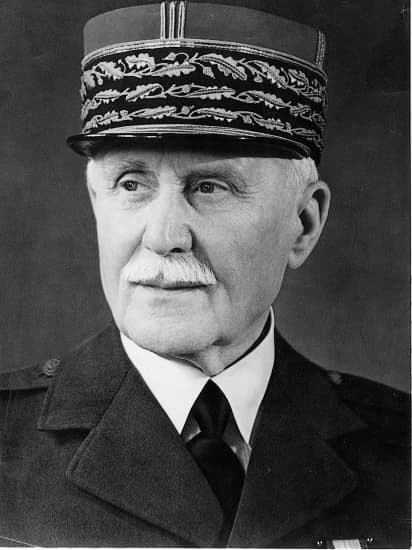
Philippe Pétain
----------------YOUTUBE-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La fin de la guerre de position et la reprise de la guerre de mouvement (1917-1918)
À partir de 1917 et 1918, plusieurs facteurs changent la
donne, permettant le retour de la guerre de mouvement. L’entrée
des États-Unis dans le conflit : En 1917, l'entrée des
États-Unis dans la guerre apporte un renfort considérable aux
Alliés, en hommes et en matériel. Cette aide booste le moral des
troupes alliées et force l'Allemagne à se défendre sur plusieurs
fronts.
Offensives alliées : En 1918, les Alliés lancent une série
d'offensives qui brisent la guerre de position qui poussent les
troupes allemandes à la retraite.
Retraite allemande et armistice : L'armée allemande, épuisée et
affaiblie par la guerre, subit de lourdes défaites. Le 11
novembre 1918, l’armistice est signé, mettant fin aux combats.
Mots clefs
Guerre d’usure
Un conflit dans lequel chaque camp inflige progressivement des
pertes à l’adversaire, épuisant ses ressources et son moral.
Armistice
La cessation des hostilités, signée le 11 novembre 1918, qui
marque la fin effective des combats.
Les civils pendant la Première Guerre Mondiale
Pendant la Première Guerre mondiale en France, les civils ont
joué un rôle crucial. Alors que les hommes étaient au front, ce
sont principalement les femmes qui ont pris en charge les tâches
dans les usines, les champs et d'autres secteurs essentiels à
l'effort de guerre. Elles ont ainsi assuré la production de
munitions, de nourriture et d'autres ressources nécessaires pour
soutenir l'armée.
Les civils ont aussi dû faire face à des conditions de vie
extrêmement difficiles. Des millions de Français ont été
déplacés en raison des combats ou de l'occupation allemande, et
de nombreuses régions ont été dévastées par les bombardements et
les combats. Les familles ont perdu des proches, et les femmes,
souvent seules à gérer leur foyer, ont dû faire face à des défis
considérables.
Sur le plan social, les civils ont soutenu les soldats en
envoyant des colis et en entretenant des liens avec eux, tout en
faisant preuve d'une grande solidarité pour les veuves, les
orphelins et les blessés. Certains ont également participé à des
actions de résistance, notamment dans les zones occupées, malgré
les risques.
En somme, bien qu'ils n'aient pas combattu directement, les
civils ont été des acteurs essentiels de la guerre, en soutenant
l’économie, en prenant soin des blessés et des familles, et en
endurant de lourdes pertes et des conditions de vie extrêmement
dures.

Mots clefs
Déplacés
Les populations contraintes de quitter leurs domiciles à cause
des combats, des bombardements ou de l’occupation.
Actions de résistance
Les initiatives prises par les civils, parfois à grand risque,
pour contrecarrer l’occupation ou soutenir l’effort de guerre.
----------------YOUTUBE-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La fin de la guerre
La fin de la Première Guerre mondiale survint en 1918 après
quatre années d’un conflit dévastateur. Plusieurs facteurs
contribuèrent à la défaite de l’Allemagne. D’abord,
l’arrivée en 1917 des États-Unis aux côtés des Alliés
apporta un soutien économique et militaire décisif. Ensuite,
l’Allemagne, épuisée par la guerre, subissait des pénuries
alimentaires, des révoltes populaires et des mutineries au sein
de son armée.
En novembre 1918, le Kaiser Guillaume II abdiqua, et un nouveau
gouvernement allemand, sous la pression des forces alliées,
signa l’armistice le 11 novembre 1918 dans un wagon à
Compiègne. Le traité de Versailles, signé en juin 1919,
officialisa la fin du conflit.
Ce traité imposa de lourdes réparations économiques et
territoriales à l’Allemagne, la tenant responsable de la
guerre. Ces conditions humiliaient l’Allemagne et créèrent un
terreau fertile pour de futures tensions, qui mèneront à la
Seconde Guerre mondiale.

Bilan et situation en Europe le lendemain de la Iere G.M
Un bilan humain et matériel catastrophique
Victimes : Plus de 10 millions de morts et environ 20 millions
de blessés (soldats et civils). Certaines régions, comme le nord
de la France ou la Belgique, sont ravagées.
Économies dévastées : L'Europe est endettée, notamment envers
les États-Unis, qui émergent comme une puissance économique
mondiale.
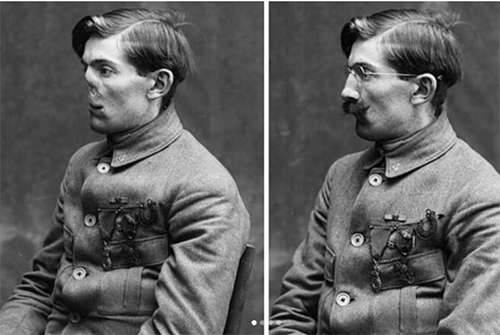
Traumatismes sociaux
Le souvenir de la guerre et des horreurs des tranchées laisse une marque profonde sur les sociétés européennes.
Une carte de l'Europe redessinée
Chute des empires :
L'Empire allemand devient la République de Weimar.
L'Empire austro-hongrois se disloque, donnant naissance à de
nouveaux États : Autriche, Hongrie, Tchécoslovaquie,
Yougoslavie.
L'Empire ottoman perd la majorité de ses territoires européens.
L'Empire russe, affaibli par la Révolution de 1917, perd des
territoires qui deviennent indépendants : Finlande, Estonie,
Lettonie, Lituanie, Pologne.
Nouveaux États : La Pologne est recréée, et de nombreux petits
États naissent, mais les tensions ethniques demeurent.
Le traité de Versailles (1919) et ses conséquences
Sanctions contre l’Allemagne :
L'Allemagne est déclarée responsable de la guerre.
Elle doit payer des réparations financières exorbitantes et cède
des territoires (Alsace-Lorraine à la France, des régions à la
Pologne et au Danemark).
Sa puissance militaire est drastiquement réduite.
Insatisfactions :
L'Allemagne considère le traité comme une humiliation (dénommé «
Diktat »). Son armée est limitée à 100 000 hommes, sa marine est
réduite et elle ne doit plus avoir d'aviation.
L'Italie, malgré son alliance avec les vainqueurs, est frustrée
de ses gains territoriaux insuffisants.
En Europe de l'Est, les nouvelles frontières ne résolvent pas
les tensions ethniques.
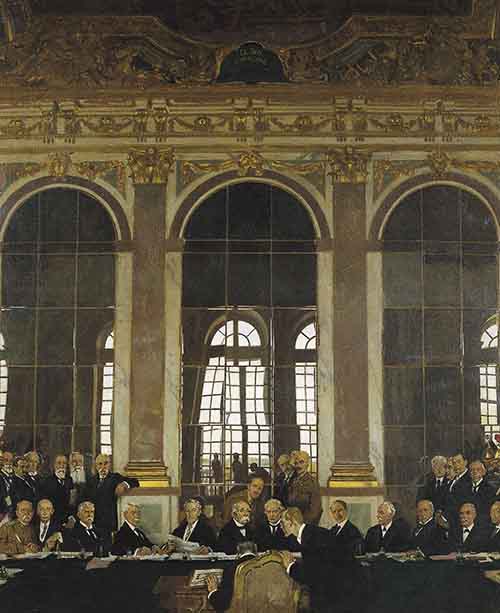
Mots clefs
Réparations économiques et territoriales
Les compensations financières et les pertes de territoires que
l’Allemagne devait supporter en conséquence du traité,
considérées comme humiliantes et sources de ressentiment.
Abdication du Kaiser Guillaume II
La démission du dernier empereur allemand, qui a précipité le
changement de régime et contribué à la fin de la guerre.
Dislocation des empires (ottoman, russe,
austro-hongrois)
Le démantèlement des grandes puissances européennes et la
réorganisation de la carte politique du continent après la
guerre.
Diktat
Terme utilisé par l’Allemagne pour décrire le traité de
Versailles, perçu comme une imposition unilatérale et
humiliante par les Alliés.
----------------YOUTUBE-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------YOUTUBE-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La Société des Nations (SDN)
Créée en 1920 pour maintenir la paix, la SDN reflète les
idéaux de coopération internationale portés par le président
américain Wilson.
Cependant, elle est affaiblie dès le départ par l'absence des
États-Unis, qui refusent de la rejoindre, et par son incapacité
à prévenir les conflits futurs.
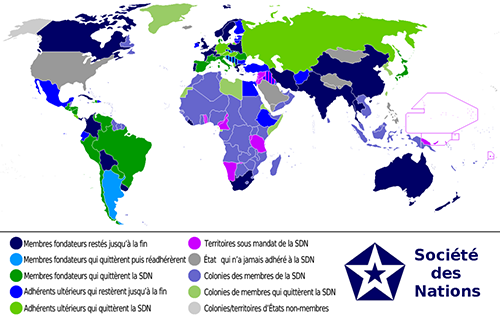
----------------YOUTUBE-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le génocide armenien
Le génocide arménien est un massacre systématique perpétré
par l’Empire ottoman contre la population arménienne entre 1915
et 1916, durant la Première Guerre mondiale.
Contexte
Les Arméniens, une minorité chrétienne vivant principalement
dans l’est de l’Empire ottoman, étaient accusés par le
gouvernement ottoman de soutenir les ennemis de l’empire,
notamment la Russie. Le gouvernement des Jeunes-Turcs, au
pouvoir, décide d’éliminer cette population qu’il considère
comme une menace.
Les massacres
Le 24 avril 1915 marque le début du génocide : des centaines
d’intellectuels et de leaders arméniens sont arrêtés et
exécutés. Ensuite, des centaines de milliers d’Arméniens sont
déportés vers des déserts comme celui de Syrie, où ils
meurent de faim, de soif ou d’épuisement.
Des hommes sont tués sur place, tandis que les femmes, enfants
et vieillards subissent des marches de la mort. Beaucoup sont
victimes de violences, de massacres ou d’enlèvements.
Bilan
Environ 1,2 à 1,5 million d’Arméniens ont été tués, ce qui
représente une grande partie de la population arménienne de
l’époque.
Reconnaissance
Le génocide arménien est encore un sujet controversé
aujourd’hui. Certains pays, dont la Turquie, refusent de
reconnaître ces événements comme un génocide, tandis que
d’autres, comme la France ou les Etats-Unis, le reconnaissent
officiellement. Ce génocide est considérécomme le premier
génocide du XXe siècle et un symbole de l’horreur des crimes de
masse.
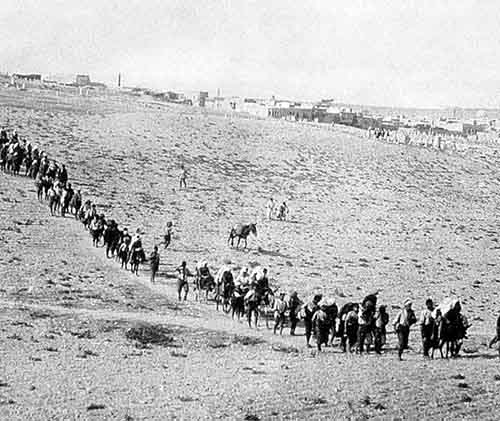
----------------YOUTUBE-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chapitre 2 : L'Europe de l'entre-deux guerre et la montée des totalitarismes
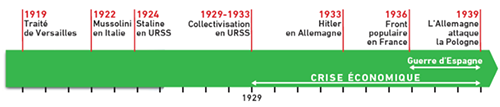
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Les révolutions russes
Qu'est ce que le communisme ?
Le communisme est une idée qui vise à créer une société sans
inégalités, où tout le monde partage les ressources et les
biens. L’objectif est d'éliminer les différences entre les
riches et les pauvres en faisant en sorte que les usines, les
terres et les ressources appartiennent à tout le monde, et non à
des individus.
Selon Karl Marx, le communisme est l’étape finale après le
capitalisme, où les classes sociales disparaissent et où l’État
n’a plus de pouvoir. Chacun contribuerait à la société selon ses
capacités et recevrait selon ses besoins.
Historiquement, certains pays comme l’Union soviétique ont
appliqué le communisme avec un parti unique au pouvoir.
Cependant, ces régimes sont souvent critiqués car ils ne
suivaient pas toujours les principes idéaux du communisme.
Avant Marx, certains penseurs avaient aussi imaginé des sociétés
plus égalitaires, mais sans se concentrer sur les luttes de
classes. Aujourd’hui, le terme "communisme" est parfois utilisé
pour parler de toute idéologie qui s'oppose au capitalisme, même
si ce n'est pas exactement ce que Marx proposait.
En résumé, le communisme cherche à créer une société plus
égalitaire sans propriété privée, mais les façons de l'appliquer
ont varié au fil du temps.
Mots clefs
Lutte des classes
Le conflit entre les différentes classes sociales (par
exemple, bourgeoisie et prolétariat) qui, selon Marx, est
moteur de l’évolution historique vers le communisme.
Nationalisation
Le processus par lequel l’État prend le contrôle des
industries, des terres et des ressources, souvent pour
redistribuer équitablement les richesses.
----------------YOUTUBE-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------YOUTUBE-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Les révolutions russes
La Révolution de Février : En Russie, la guerre, les pénuries alimentaires et les conditions de vie précaires ont provoqué un mécontentement général. Les travailleurs, soldats et paysans se sont rebellés contre le tsar Nicolas II, contraint d'abdiquer. La monarchie a ainsi été renversée, et un gouvernement provisoire a pris le pouvoir, mais il n'a pas réussi à améliorer la situation.

----------------YOUTUBE-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------YOUTUBE-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La création de l'URSS
L'URSS (Union des Républiques Socialistes Soviétiques) a été
créée en 1922, après la révolution russe de 1917. Après avoir
renversé le tsar, les bolcheviks dirigés par Lénine ont pris le
pouvoir et ont instauré un système communiste, où l'État
contrôlait les terres et les industries.
Suite à la Révolution d'Octobre, la Russie a traversé une guerre
civile entre les bolcheviks (les Rouges) et les forces opposées
(les Blancs). Les Rouges ont gagné en 1921 et ont consolidé leur
pouvoir. Lénine a alors unifié plusieurs régions sous un même
gouvernement communiste.
L'URSS est officiellement née en 1922, regroupant la Russie,
l'Ukraine, la Biélorussie et la Transcaucasie. Ce nouvel État
était dirigé par le Parti bolchevik. Après la mort de Lénine en
1924, Joseph Staline est devenu le leader et a renforcé encore
plus le contrôle autoritaire sur tout le pays.
----------------YOUTUBE-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------YOUTUBE-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lénine
Vladimir Lénine, né en 1870, était un révolutionnaire russe et
le principal leader de la Révolution d'Octobre 1917, qui a
renversé le régime tsariste. Il a fondé le Parti bolchevique et
dirigé la naissance de l'Union soviétique en 1922.
Lénine a instauré un régime communiste basé sur les idées de Karl
Marx, mais avec sa propre approche, notamment la prise de pouvoir
par les ouvriers et les paysans. Il est resté à la tête du pays
jusqu'à sa mort en 1924, après quoi Joseph Staline a pris sa
place.
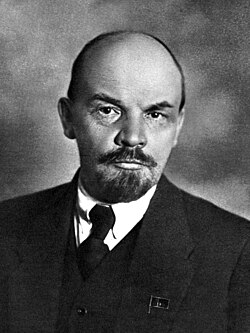
Lenine
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le Fascisme Italien - 1919-39
La montée du fascisme en Italie repose sur les idées de Benito
Mussolini, qui fonde les Fasci di Combattimento en 1919.
Nationalisme extrême : Restaurer la grandeur de l'Italie, en
rappelant l'Empire romain, et étendre son territoire.
État autoritaire : Concentrer le pouvoir entre les mains d'un chef
unique, rejetant la démocratie et les partis politiques
traditionnels.
Anticommunisme : Combattre les mouvements ouvriers et la menace
communiste, perçue comme un danger pour l’ordre social.
Corporatisme : Remplacer les conflits entre patrons et ouvriers
par une organisation économique où l'État contrôle et harmonise
les relations sociales.
Répression et discipline : Promouvoir l’ordre, la violence
légitime et l’obéissance pour éliminer les opposants et rétablir
la stabilité.
Ces idées séduisent une partie des Italiens face à la crise
économique, au désordre social et à l’échec des institutions
démocratiques.
En 1922, après la Marche sur Rome, Mussolini est nommé chef du
gouvernement. Il impose progressivement une dictature fasciste dès
1925, en supprimant les libertés et en contrôlant tous les aspects
de la société.

Benito Mussolini
Benito Mussolini était un homme politique italien, fondateur du
fascisme, un régime autoritaire. Né en 1883, il a d'abord été
socialiste avant de se tourner vers des idées nationalistes et
dictatoriales. En 1922, il prend le pouvoir en Italie, où il
établit une dictature, en contrôlant le gouvernement, la presse et
les syndicats. Mussolini a également allié l'Italie à l'Allemagne
nazie pendant la Seconde Guerre mondiale, avant d’être renversé en
1943 et exécuté en 1945.
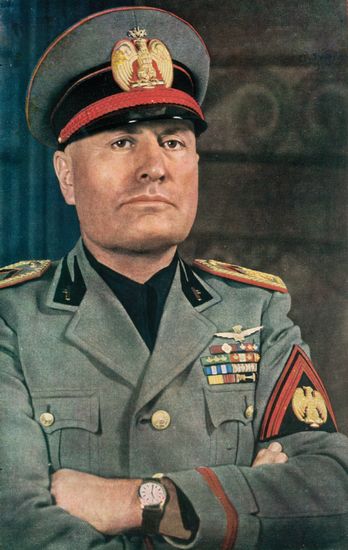
Benito Mussolini
----------------YOUTUBE-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------YOUTUBE-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
L'Allemagne Nazie
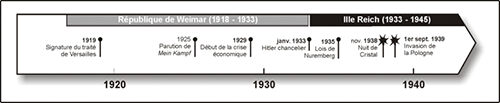
Frise chronologique, l'Allemagne de la république de Weimar à la fin du IIIe Reich - source : hgsempai.fr
La montee du nazisme (1919-1933)
Apres la Premiere Guerre mondiale, l’Allemagne subit une crise
profonde : humiliation du traité de Versailles (1919), crise
économique et sociale, et rejet de la République de Weimar.
Dans ce contexte, Adolf Hitler rejoint le parti nazi (NSDAP),
fondé en 1920, qui défend un programme nationaliste,
antisémite et anti-communiste.
Après l’échec du putsch de Munich (1923), Hitler restructure
le parti et développe une propagande efficace, notamment
auprès des classes moyennes et des chômeurs.
La crise économique mondiale de 1929 provoque un chômage
massif et une instabilité politique, créant un terreau
favorable à la montée des extrêmes.
Le NSDAP gagne rapidement en popularité, devenant le premier
parti du Reichstag en 1932 grâce à ses promesses de
redressement national. Les conservateurs, pensant manipuler
Hitler, le nomment chancelier le 30 janvier 1933.
Une fois au pouvoir, Hitler profite de l’incendie du Reichstag
pour restreindre les libertes et, grâce à la loi des pleins
pouvoirs de mars 1933, élimine toute opposition. La Republique
de Weimar s’effondre, laissant place à la dictature nazie.
----------------YOUTUBE-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adolph Hitler
Adolf Hitler, né en 1889 en Autriche, devient le leader du
Parti nazi en Allemagne dans les années 1920. Après un échec de
coup d’État en 1923, il est emprisonné et écrit Mein Kampf, où
il expose ses idées ultranationalistes et antisémites.
En 1933, il est nommé chancelier d’Allemagne et instaure
rapidement une dictature, éliminant les opposants et réarmant le
pays.
En 1939, il déclenche la Seconde Guerre mondiale en envahissant
la Pologne. Pendant la guerre, il met en œuvre l'Holocauste,
tuant six millions de Juifs et des millions d'autres victimes.
L'armée nazie envahit une grande partie de l'Europe avant de
subir une série de défaites.
En 1945, avec la défaite imminente de l'Allemagne, Hitler se
suicide dans son bunker à Berlin.

Adolf Hitler
Film : Hitler - La naissance d'un Monstre - 2003 /
Realisateur : Christian Duguay
----------------YOUTUBE-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------YOUTUBE-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------YOUTUBE-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mein Kampf : Les idées d'Adolph Hitler
Mein Kampf, écrit par Adolf Hitler, présente ses idées sur la
politique, la race et la nation. Il y exprime sa vision d'une
Allemagne forte et expansionniste, basée sur l'idée de la
supériorité de la "race aryenne". Hitler prône l'anti-sémitisme,
considérant les Juifs comme responsables de nombreux maux dans
la société.
Il propose également l'éradication de ce qu'il considère comme
des races inférieures, notamment les Slaves et les Juifs. Sur le
plan politique, il rejette la démocratie et favorise un régime
autoritaire, avec un pouvoir centralisé sous la forme d'un
Führer. Enfin, il défend l'idée de l'expansion territoriale de
l'Allemagne en Europe de l'Est pour assurer sa "vitalité" et sa
domination.
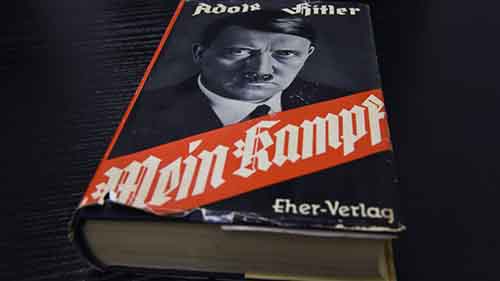
----------------YOUTUBE-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Film : La Vague - 2007 / Réalisateur : Dennis Gansel
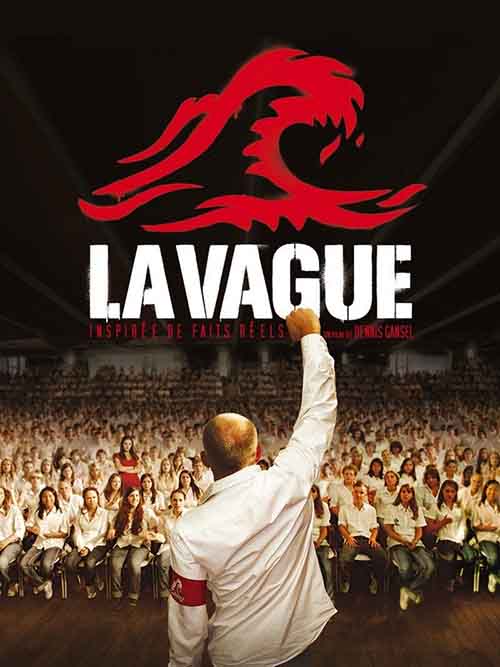
La crise de 1929
La crise de 1929, aussi appelée la "Grande Dépression", a
été une grave crise économique mondiale qui a commencé aux
États-Unis avec le krach boursier d'octobre 1929. Les actions
ont perdu de la valeur, ce qui a provoqué la faillite de
nombreuses entreprises et banques. Cela a entraîné une chute
de la production, une forte hausse du chômage et une récession
dans de nombreux pays européens, affectant particulièrement
l'agriculture et l'industrie.
La crise a duré plusieurs années et a eu des conséquences
profondes sur l'économie mondiale.

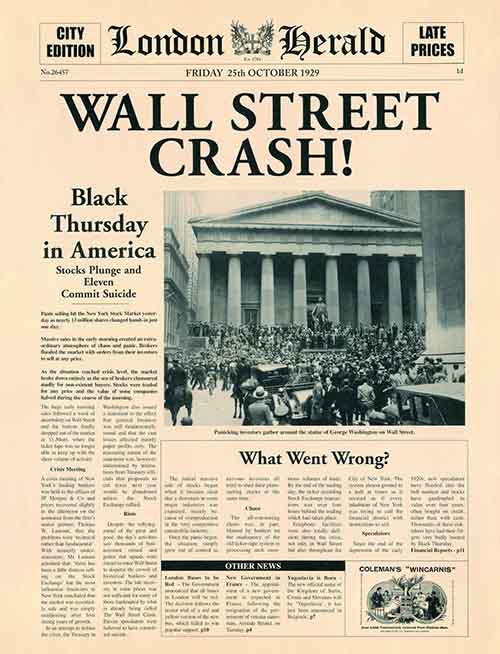
----------------YOUTUBE-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le régime nazi Nazie de 1933 à 1939
En janvier 1933, Hitler devient chancelier. Il profite de
l'incendie du Reichstag en février pour suspendre les libertés
et réprimer ses opposants. En mars, il obtient les pleins
pouvoirs et met fin à la démocratie allemande.
Il interdit les partis politiques et instaure un régime
totalitaire avec la Gestapo et la SS, soutenu par une forte
propagande.

En juin 1934, il élimine les dirigeants des SA pour affirmer
son autorité. Après la mort du président Hindenburg en août
1934, Hitler devient "Führer", cumulant les fonctions de
chancelier et président.
Sur le plan intérieur, il relance l'économie par des grands
travaux et l'armement, réduisant le chômage. La société est
contrôlée : la jeunesse est endoctrinée, le culte du chef est
omniprésent et l'opposition est réprimée. 
L'antisémitisme devient une politique d'État avec les lois de
Nuremberg en 1935, et la Nuit de Cristal en 1938 marque une
intensification de la persécution des Juifs.

Sur le plan international, Hitler poursuit une politique
expansionniste, violant le traité de Versailles. En 1936, il
remilitarise la Rhénanie, puis annexe l'Autriche en 1938. Il
obtient les Sudètes après les accords de Munich, puis envahit
la Tchécoslovaquie en 1939. En août 1939, il signe un pacte de
non-agression avec l'URSS, prévoyant le partage de la Pologne.
Entre 1933 et 1939, Hitler transforme l'Allemagne en un État
totalitaire et militarisé, préparant ainsi la guerre.
Les hauts dignitaires du régime
Heinrich Himmler : Chef de la SS et principal architecte de la Shoah, responsable des camps de concentration et d'extermination.

Hermann Göring : Chef de la Luftwaffe (armée de l'air), numéro deux du régime au début, et principal dirigeant économique du Reich.

Joseph Goebbels : Ministre de la Propagande, chargé du contrôle des médias et de l'endoctrinement de la population.

Martin Bormann : Secrétaire personnel d’Hitler, exerçant une grande influence dans l’administration du Reich.

Rudolf Hess : Adjoint d’Hitler, connu pour son vol en Écosse en 1941 dans une tentative (ratée) de négociation avec le Royaume-Uni.

Albert Speer : Ministre de l'Armement et architecte du Reich, chargé de la production militaire.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
L’URSS de Staline
De 1924 à 1939, l'Union soviétique sous Staline connaît une
transformation radicale. Après la mort de Lénine, Staline
élimine ses rivaux et instaure un régime totalitaire basé sur
la terreur, la propagande et un culte de la personnalité.

Sur le plan économique, il impose la collectivisation forcée
de l’agriculture, ce qui cause des famines, notamment
l'Holodomor en Ukraine (1932-1933), et mène à la mort de
millions de personnes. Parallèlement, l'industrialisation est
accélérée par des plans quinquennaux, mais les conditions de
travail sont extrêmement dures.
La répression est également omniprésente, avec les Grandes
Purges de 1936 à 1938 où des milliers d'opposants sont
exécutés ou envoyés au Goulag.

Sur la scène internationale, l'URSS soutient les républicains
pendant la guerre d'Espagne et, face à la menace nazie, signe
un pacte de non-agression avec Hitler en 1939, comprenant un
partage secret de la Pologne et de l'Europe de l'Est.

----------------YOUTUBE-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------YOUTUBE-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comparatif des régimes totalitaires (1919-1939)
| Pays | Dirigeant | Idéologie | Parti | Symboles | Contrôle | Objectifs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| URSS | Staline | Communisme | PCUS | Faucille, drapeau rouge | NKVD, goulag, propagande | Égalité, industrialisation |
| Allemagne | Hitler | Nazisme | NSDAP | Croix gammée, salut nazi | Gestapo, propagande | Aryens, conquête |
| Italie | Mussolini | Fascisme | Parti fasciste | Faisceau, chemises noires | OVRA, jeunesse encadrée | Empire romain, nationalisme |
Points communs des régimes totalitaires :
- Un parti unique
- Un chef tout-puissant (culte de la personnalité)
- Propagande et censure
- Répression des opposants
- Embrigadement de la jeunesse
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La France de l’entre deux guerres
1) 1919-1929
Entre 1919 et 1929, la France se reconstruit après la
Première Guerre mondiale, marquée par de lourdes pertes
humaines et des destructions massives. Le Traité de Versailles
(1919) impose des réparations à l’Allemagne, mais leur
paiement devient source de tensions, notamment avec
l’occupation de la Ruhr en 1923. Politiquement, l’instabilité
domine avec l’alternance entre le Bloc national (droite) et le
Cartel des gauches (radicaux et socialistes), qui échoue à
stabiliser la situation.
En 1926, Raymond Poincaré revient au pouvoir et redresse
l’économie grâce à la stabilisation du franc (1928). La fin
des années 1920 est marquée par la prospérité des “Années
folles”, avec une croissance industrielle et culturelle.
Cependant, les inégalités sociales et les tensions politiques
persistent. En 1929, la crise économique mondiale menace cet
équilibre fragile et annonce de nouvelles difficultés pour la
France.

----------------YOUTUBE-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------YOUTUBE-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2) 1929-1936
La crise de 1929, bien que tardive, entraîne une forte
récession à partir de 1931 : la production industrielle chute,
le chômage augmente et les inégalités s’aggravent. Les
gouvernements successifs, principalement radicaux et modérés,
appliquent une politique d’austérité pour stabiliser le franc,
ce qui accentue les tensions sociales.
Face à la crise, les mouvements d’extrême droite gagnent en
influence. Le 6 février 1934, une manifestation des ligues
dégénère en émeute devant l’Assemblée nationale, menaçant la
République. En réaction, la gauche s’unit et forme le Front
populaire, regroupant socialistes, communistes et radicaux.

En mai 1936, le Front populaire, dirigé par Léon Blum,
remporte les élections législatives. Son gouvernement met en
place des réformes sociales majeures : semaine de 40 heures,
congés payés, augmentation des salaires, soutenues par une
forte mobilisation ouvrière. Cependant, le gouvernement Blum
fait face à des résistances patronales, à une situation
économique difficile et à des divisions internes.

----------------YOUTUBE-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3) 1937-1939
En 1936, le Front populaire, dirigé par Léon Blum, met en
place des réformes sociales majeures : semaine de 40 heures,
congés payés, nationalisations. Cependant, ces avancées se
heurtent aux résistances patronales et à une crise économique
persistante. En politique étrangère, la non-intervention dans
la guerre d’Espagne divise la gauche.
En 1937, Blum démissionne et Édouard Daladier prend le
pouvoir, adoptant une politique plus conservatrice et lançant
le réarmement face à la montée des tensions en Europe.

En 1938, la France signe les Accords de Munich, espérant
éviter la guerre en laissant Hitler annexer les Sudètes. Mais
en 1939, l’Allemagne envahit la Tchécoslovaquie, puis la
Pologne en septembre. Face à cette agression, la France et le
Royaume-Uni déclarent la guerre à l’Allemagne : la Seconde
Guerre mondiale commence.

La Seconde Guerre mondiale (1939-1945)
----------------YOUTUBE-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Une guerre mondiale et totale
La Seconde Guerre mondiale débute le 1er septembre 1939, lorsque l’Allemagne d’Hitler envahit la Pologne. En réaction, la France et le Royaume-Uni déclarent la guerre à l’Allemagne. Cette guerre s’étend rapidement à l’Europe entière, puis au monde entier. Elle oppose deux camps : les puissances de l’Axe (Allemagne, Italie, Japon) contre les Alliés (France libre, Royaume-Uni, États-Unis, URSS…).
Dès le début du conflit, l’Allemagne utilise la tactique de la guerre éclair (Blitzkrieg) pour envahir rapidement plusieurs pays : Danemark, Norvège, Belgique, Pays-Bas, puis la France en juin 1940. La France est vaincue en quelques semaines et signe l’armistice. Le maréchal Pétain met en place un régime autoritaire à Vichy, qui collabore avec l’Allemagne nazie.
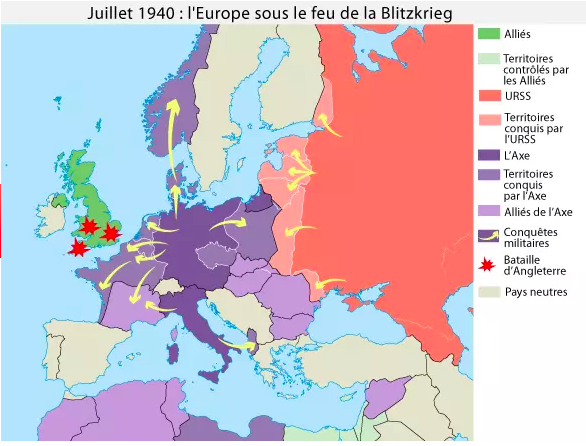
En 1941, Hitler attaque l’Union soviétique malgré le pacte de non-agression signé en 1939. La même année, le Japon, allié de l’Allemagne, attaque la base américaine de Pearl Harbor le 7 décembre 1941. Cette attaque provoque l’entrée en guerre des États-Unis, donnant au conflit une véritable dimension mondiale.

7 décembre 1941 : Les Japonais attaquent Pearl Harbor
Mots clefs
Blitzkrieg
Stratégie militaire utilisée par l'Allemagne nazie pour
obtenir des victoires rapides grâce à des attaques surprises
et coordonnées.
Armistice
Accord mettant fin aux combats entre deux armées, sans pour
autant signer la paix définitive.
----------------YOUTUBE-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Le tournant de la guerre
Pendant les premières années, l’Axe semble invincible. Mais à partir de 1942, plusieurs événements marquent un tournant décisif. Sur le front de l’Est, les Soviétiques remportent une grande victoire à la bataille de Stalingrad (1942-1943), où l’armée allemande est vaincue après des mois de combats très violents.
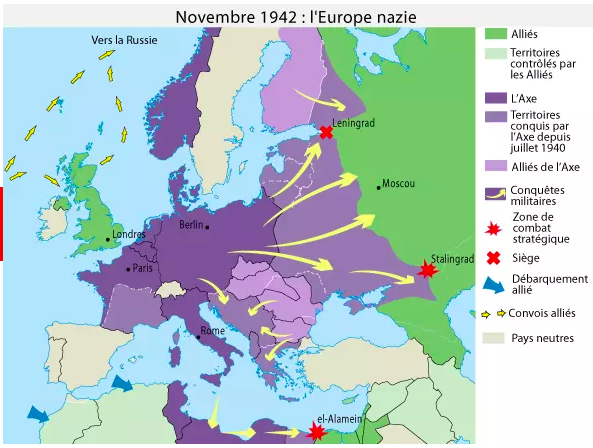

Bataille de Stalingrad
----------------YOUTUBE-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------YOUTUBE-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------YOUTUBE-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dans le Pacifique, les Américains remportent la bataille de Midway en juin 1942 contre le Japon. À partir de ce moment, les Alliés reprennent l’initiative et lancent des offensives pour libérer les territoires occupés.
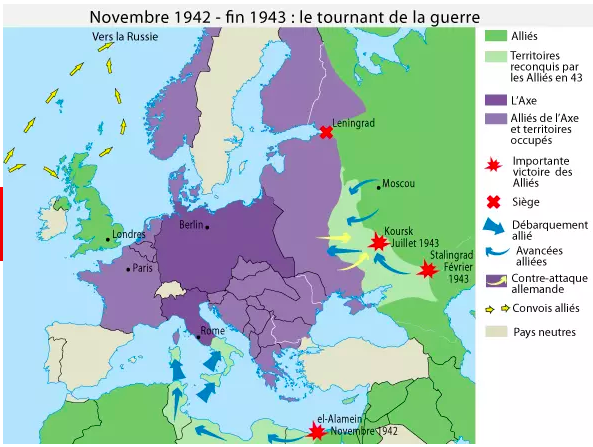
Le 6 juin 1944, les Alliés débarquent en Normandie (opération
Overlord). Cette opération militaire massive permet la
libération progressive de la France. Paris est libérée le 25
août 1944.
----------------YOUTUBE-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------YOUTUBE-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------YOUTUBE-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------YOUTUBE-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------YOUTUBE-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Puis, les armées alliées avancent vers l’Allemagne. Le 8 mai 1945, l’Allemagne capitule : c’est la fin de la guerre en Europe.----------------YOUTUBE-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------YOUTUBE-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------YOUTUBE-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------YOUTUBE-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------YOUTUBE-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
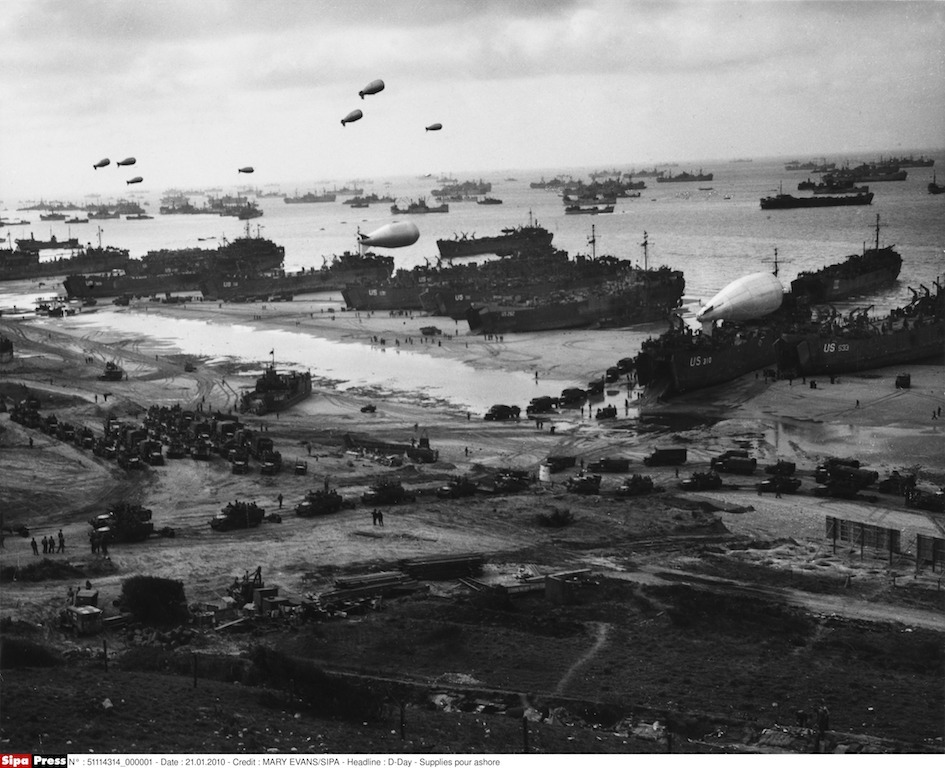
Le débarquement en Normandie
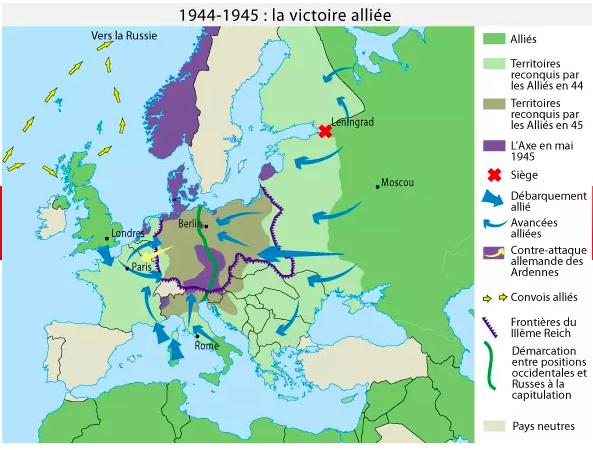
Mais la guerre continue dans le Pacifique. Pour contraindre le
Japon à capituler, les États-Unis utilisent une nouvelle arme :
la bombe atomique. Deux bombes sont larguées sur Hiroshima (6
août 1945) et Nagasaki (9 août 1945), causant des centaines de
milliers de morts. Le 2 septembre 1945, le Japon capitule.
C’est la fin de la Seconde Guerre mondiale.
----------------YOUTUBE-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
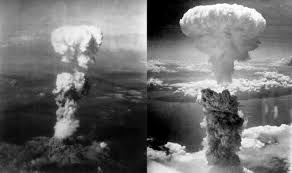
Les bombardements d'Hiroshima et de Nagazaki

Les bombardements d'Hiroshima et de Nagazaki
Mots clefs
Stalingrad
Ville soviétique où eut lieu l’une des batailles les plus
décisives et meurtrières de la guerre, marquant le début du
recul allemand.
Opération Overlord
Nom de code du débarquement des forces alliées en Normandie le
6 juin 1944.
3. Une guerre d’anéantissement
La Seconde Guerre mondiale est une guerre d’anéantissement. Cela signifie que les ennemis cherchent non seulement à vaincre militairement, mais aussi à détruire complètement leurs adversaires. Il n’y a pas de distinction entre civils et militaires.
Les combats sont d’une violence extrême, notamment sur le front
de l’Est, entre l’Allemagne et l’URSS. Les bombardements
détruisent de nombreuses villes et tuent des milliers de civils
: Londres, Dresde, Tokyo, Le Havre ou encore Caen.
----------------YOUTUBE-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Les nazis massacrent aussi des populations entières, comme à Oradour-sur-Glane, en France, où 643 civils sont tués en 1944.
Les décombres d'Oradour sur Glane
----------------YOUTUBE-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cette guerre utilise tous les moyens possibles : économiques, scientifiques, psychologiques. Des dizaines de millions de personnes participent à l’effort de guerre, que ce soit sur le front ou à l’arrière.
Mots clefs
Guerre d’anéantissement
Conflit visant à détruire totalement l’ennemi, y compris les
civils, par tous les moyens disponibles.
Oradour-sur-Glane
Village français détruit en 1944 par les nazis, symbole des
massacres de civils pendant la guerre.
----------------YOUTUBE-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Le génocide des Juifs et des Tziganes
Le régime nazi, fondé sur l’idéologie raciste et antisémite, mène un génocide, c’est-à-dire l’extermination organisée de tout un peuple. Dès 1941, les nazis mettent en place la Solution finale : un plan pour tuer tous les Juifs d’Europe.
Dans un premier temps, les nazis procèdent à des fusillades de masse, notamment dans les pays de l’Est (comme à Babi Yar, en Ukraine). Ensuite, ils construisent des camps d’extermination comme Auschwitz, Treblinka, Sobibor, où les victimes sont assassinées dans des chambres à gaz. Le système est industrialisé, méthodique, impitoyable.

Entrée en train d'Auschwitz

Photo de déportés à Auschwitz

Le tri des prisonniers dès l'arrivée à Aushwitz
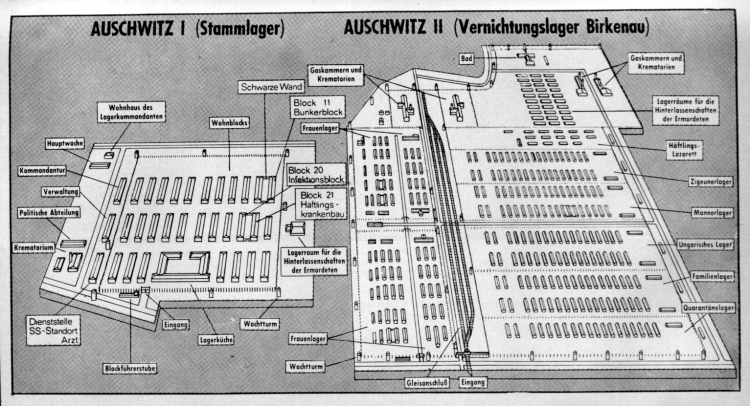
Plan d'Auschwitz
Environ 6 millions de Juifs sont exterminés, ainsi que 250 000 à 500 000 Tziganes. Ce crime contre l’humanité est appelé la Shoah. À la fin de la guerre, les Alliés découvrent l’horreur des camps. Cela bouleverse le monde entier.
----------------YOUTUBE-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------YOUTUBE-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------YOUTUBE-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mots clefs
Génocide
Extermination volontaire, systématique et planifiée d’un
groupe humain en raison de son origine, sa religion, ou sa
culture.
Shoah
Terme hébreu signifiant “catastrophe”, utilisé pour désigner
l’extermination des Juifs par les nazis.
5. La France pendant la guerre
En juin 1940, la France est battue et divisée en deux zones : une zone occupée au nord, sous le contrôle des Allemands, et une zone libre au sud, dirigée par le régime de Vichy, dirigé par le maréchal Pétain. Ce régime autoritaire supprime les libertés, exclut les Juifs et collabore avec les nazis.

Affiche de propagande du régime de Vichy

Pétain rencontrant Hitler, cette image est un symbole de la collaboration
----------------YOUTUBE-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mais tous les Français n’acceptent pas la défaite. Le général de Gaulle, réfugié à Londres, lance un appel à la résistance le 18 juin 1940. Il crée la France libre et encourage les Français à continuer le combat.
----------------YOUTUBE-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Charles de Gaulle
Appel prononcé à la radio de Londres - 18 juin 1940

« Les chefs qui, depuis de nombreuses années, sont à la tête
des armées françaises, ont formé un gouvernement. Ce
gouvernement, alléguant la défaite de nos armées, s'est mis en
rapport avec l'ennemi pour cesser le combat.
Certes, nous avons été, nous sommes submergés par la force
mécanique, terrestre et aérienne de l'ennemi.
Infiniment plus que leur nombre, ce sont les chars, les
avions, la tactique des Allemands qui nous font reculer. Ce
sont les chars, les avions, la tactique des Allemands qui ont
surpris nos chefs au point de les amener là où ils en sont
aujourd’hui.
Mais le dernier mot est-il dit ? L'espérance doit-elle
disparaître ? La défaite est-elle définitive ? Non !
Croyez-moi, moi qui vous parle en connaissance de cause et
vous dis que rien n’est perdu pour la France. Les mêmes moyens
qui nous ont vaincus peuvent faire venir un jour la victoire.
Car la France n'est pas seule ! Elle n'est pas seule ! Elle
n'est pas seule ! Elle a un vaste Empire derrière elle. Elle
peut faire bloc avec l'Empire britannique qui tient la mer et
continue la lutte.
Elle peut, comme l'Angleterre, utiliser sans limites l'immense
industrie des Etats-Unis.
Cette guerre n'est pas limitée au territoire de notre
malheureux pays. Cette guerre n'est pas tranchée par la
bataille de France. Cette guerre est une guerre mondiale.
Toutes les fautes, tous les retards, toutes les souffrances
n'empêchent pas qu'il y a, dans l'univers, tous les moyens
pour écraser un jour nos ennemis. Foudroyés aujourd'hui par la
force mécanique, nous pourrons vaincre dans l'avenir par une
force mécanique supérieure. Le destin du monde est là.
Moi, général de Gaulle, actuellement à Londres, j'invite les
officiers et les soldats français qui se trouvent en
territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver, avec
leurs armes ou sans leurs armes, j'invite les ingénieurs et
les ouvriers spécialisés des industries d'armement qui se
trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y
trouver, à se mettre en rapport avec moi.
Quoi qu'il arrive, la Flamme de la résistance française ne
doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas.
Demain, comme aujourd'hui, je parlerai à la radio de Londres.
»
Charles de Gaulle
Appel prononcé à la radio de Londres
22 juin 1940
"Le Gouvernement français, après avoir demandé l'armistice,
connaît maintenant les conditions dictées par l'ennemi.
Il résulte de ces conditions que les forces françaises de
terre, de mer et de l'air seraient entièrement démobilisées,
que nos armes seraient livrées, que le territoire français
serait totalement occupé et que le Gouvernement français
tomberait sous la dépendance de l'Allemagne et de l'Italie.
On peut donc dire que cet armistice serait non seulement une
capitulation, mais encore un asservissement.
Or, beaucoup de Français n'acceptent pas la capitulation ni la
servitude, pour des raisons qui s'appellent l'honneur, le bons
sens, l'intérêt supérieur de la Patrie.
Je dis l'honneur ! Car la France s'est engagée à ne déposer
les armes que d'accord avec ses Alliés. Tant que ses Alliés
continuent la guerre, son gouvernement n'a pas le droit de se
rendre à l'ennemi. Le Gouvernement polonais, le Gouvernement
norvégien, le Gouvernement hollandais, le Gouvernement belge,
le Gouvernement luxembourgeois, quoique chassés de leur
territoire, ont compris ainsi leur devoir.
Je dis le bon sens ! Car il est absurde de considérer la lutte
comme perdue. Oui, nous avons subi une grande défaite. Un
système militaire mauvais, les fautes commises dans la
conduite des opérations, l'esprit d'abandon du Gouvernement
pendant ces derniers combats, nous ont fait perdre la bataille
de France. Mais il nous reste un vaste Empire, une flotte
intacte, beaucoup d'or. Il nous reste des alliés, dont les
ressources sont immenses et qui dominent les mers. Il nous
reste les gigantesques possibilités de l'industrie américaine.
Les mêmes conditions de la guerre qui nous ont fait battre par
5 000 avions et 6 000 chars peuvent nous donner, demain, la
victoire par 20 000 chars et 20 000 avions.
Je dis l'intérêt supérieur de la Patrie ! Car cette guerre
n'est pas une guerre franco-allemande qu'une bataille puisse
décider. Cette guerre est une guerre mondiale. Nul ne peut
prévoir si les peuples qui sont neutres aujourd'hui le
resteront demain ; même les alliés de l'Allemagne
resteront-ils toujours ses alliés ? Si les forces de la
liberté triomphent finalement de celles de la servitude, quel
serait le destin d'une France qui se serait soumise à l'ennemi
?
L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la Patrie,
commandent à tous les Français libres de continuer le combat,
là où ils seront et comme ils pourront.
Il est, par conséquent, nécessaire de grouper partout où cela
se peut une force française aussi grande que possible. Tout ce
qui peut être réuni, en fait d'éléments militaires français et
de capacités françaises de production d'armement, doit être
organisé partout où il y en a.
Moi, Général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre,
cette tâche nationale.
J'invite tous les militaires français des armées de terre, de
mer et de l'air, j'invite les ingénieurs et les ouvriers
français spécialistes de l'armement qui se trouvent en
territoire britannique ou qui pourraient y parvenir, à se
réunir à moi.
J'invite les chefs, les soldats, les marins, les aviateurs des
forces françaises de terre, de mer, de l'air, où qu'ils se
trouvent actuellement, à se mettre en rapport avec moi.
J'invite tous les Français qui veulent rester libres à
m'écouter et à me suivre.
Vive la France libre, dans l'honneur et dans l'indépendance !
"
À l’intérieur du pays, la Résistance s’organise : des réseaux de résistants sabotent les voies ferrées, diffusent des journaux clandestins, cachent des Juifs. Des groupes armés, appelés maquis, mènent des actions contre l’occupant. En 1944, les résistants participent activement à la libération du pays.

Jean Moulin, un symbole de la résistance française

Les maquisards, résistants armés
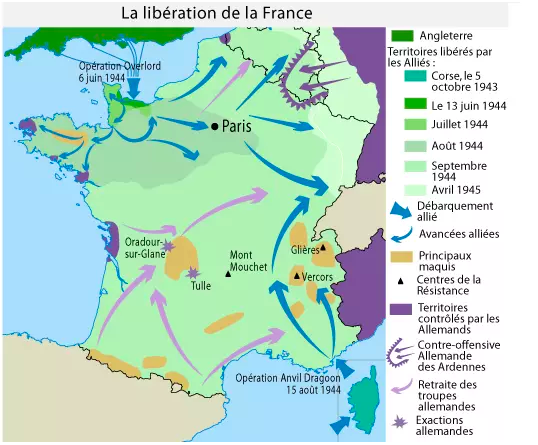
----------------YOUTUBE-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------YOUTUBE-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------YOUTUBE-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mots clefs
Régime de Vichy
Gouvernement autoritaire français dirigé par le maréchal
Pétain entre 1940 et 1944, collaborant avec l’Allemagne nazie.
Résistance
Ensemble des actions menées contre l’occupant nazi et le
régime de Vichy pendant la Seconde Guerre mondiale.
Conclusion : Le bilan de la guerre
La Seconde Guerre mondiale est le conflit le plus meurtrier de l’histoire. Elle a fait environ 60 millions de morts, dont une majorité de civils. Des villes entières sont détruites, des millions de personnes sont déplacées. Les traumatismes sont énormes, notamment à cause de la découverte des camps de concentration et d’extermination.
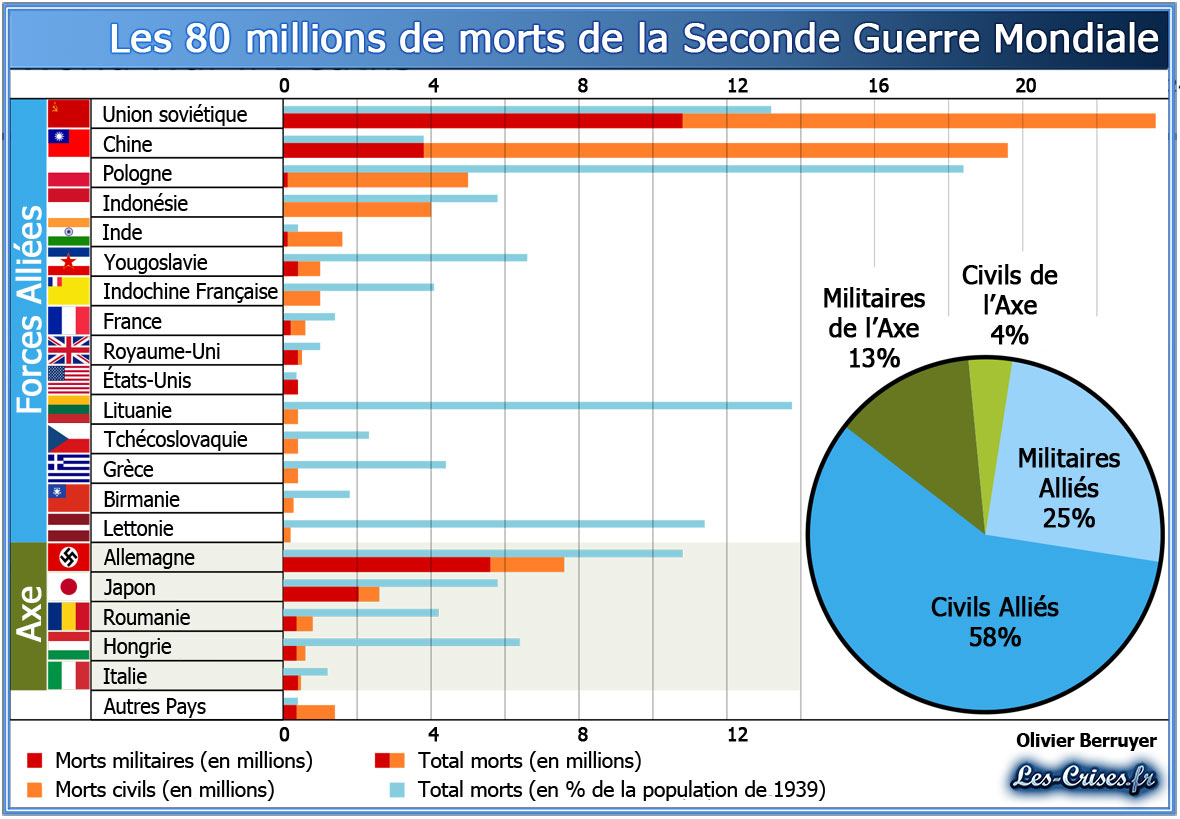
Bilan humain de la seconde guerre mondiale
Après la guerre, les vainqueurs veulent éviter qu’un tel conflit ne se reproduise. En 1945, ils fondent l’Organisation des Nations Unies (ONU) pour maintenir la paix dans le monde. Des procès, comme celui de Nuremberg, sont organisés pour juger les responsables nazis de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité.

La création de l'ONU le 26 juin 1945

Le procès de Nuremberg
----------------YOUTUBE-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mots clefs
ONU (Organisation des Nations Unies)
Organisation internationale créée en 1945 pour maintenir la
paix et la sécurité dans le monde.
Procès de Nuremberg
Procès tenus après la guerre pour juger les principaux
dirigeants nazis accusés de crimes de guerre et de crimes
contre l’humanité.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thème 2 : Le monde depuis 1945
L'indépendance et la création de nouveaux États après la Seconde Guerre mondiale
1. La décolonisation : un phénomène mondial
Après 1945, de nombreux pays colonisés réclament leur indépendance. La Seconde Guerre mondiale a affaibli les puissances coloniales européennes (France, Royaume-Uni, Pays-Bas…), et renforcé les mouvements nationalistes dans les colonies. Les peuples colonisés veulent désormais décider eux-mêmes de leur avenir.
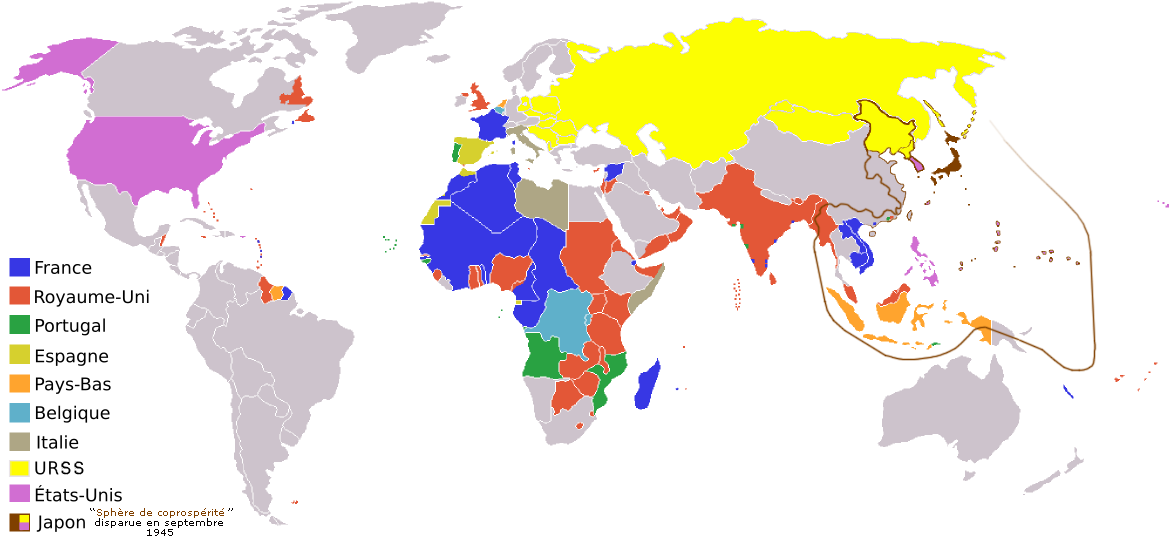
Les colonies en 1945
----------------YOUTUBE-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Les États-Unis et l’URSS, les deux grandes puissances de l’après-guerre, soutiennent globalement la décolonisation, car elle s’inscrit dans leur opposition aux anciens empires coloniaux européens. L’ONU, créée en 1945, encourage également le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Mots clefs
Décolonisation
Processus par lequel un territoire colonisé accède à
l’indépendance.
Nationalisme
Idéologie selon laquelle chaque peuple a le droit de former
une nation indépendante et souveraine.
2. Les grandes étapes de la décolonisation
La décolonisation commence en Asie, où l’Inde devient indépendante du Royaume-Uni en 1947, grâce à la lutte menée par Gandhi et le Congrès national indien. Le Pakistan est créé à la même date pour les musulmans. L’Indonésie devient indépendante des Pays-Bas en 1949, après un conflit armé.
En Afrique, le processus s'accélère dans les années 1950 et surtout 1960. De nombreux pays obtiennent leur indépendance pacifiquement (comme le Sénégal ou le Ghana), tandis que d'autres doivent mener une lutte armée (comme l’Algérie contre la France, ou l’Angola contre le Portugal).
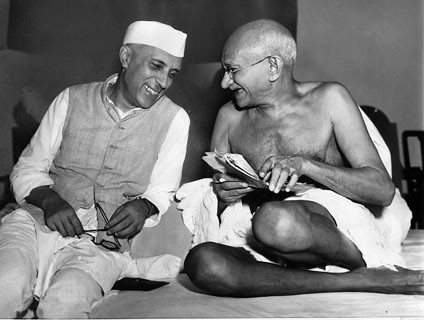
Nehru et Gandhi
Mots clefs
Indépendance
Situation d’un État qui n’est plus soumis à la domination
d’un autre pays.
Gandhi
Leader indien qui a mené une lutte non-violente pour
l’indépendance de l’Inde.
3. Des indépendances souvent difficiles
La décolonisation ne se fait pas toujours dans la paix. Certains pays doivent mener des guerres longues et violentes, comme l’Algérie (1954-1962), le Vietnam (contre la France puis les États-Unis), ou encore le Mozambique. Ces conflits font de nombreuses victimes, civiles et militaires.

1962 - Indépendance de l'Algérie
Même après l’indépendance, beaucoup de pays rencontrent des difficultés politiques et économiques. Ils doivent construire un État, rédiger une Constitution, créer une administration… Certains régimes deviennent autoritaires ou sont renversés par des coups d’État. D’autres restent dépendants économiquement des anciennes puissances coloniales.
----------------YOUTUBE-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------YOUTUBE-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mots clefs
Guerre d’indépendance
Conflit armé mené par un peuple colonisé pour obtenir son
autonomie politique.
Coups d’État
Prise de pouvoir soudaine et illégale, souvent par la force,
par une partie de l’armée ou un groupe politique.
4. La naissance de nouveaux états
Inde et Pakistan (1947) : indépendance du Royaume-Uni
Indonésie (1949) : indépendance des Pays-Bas
Pays d’Afrique (années 1950-60) : indépendance de la France,
du Royaume-Uni, de la Belgique, etc.
L’onu créée en 1945) soutient le droit des peuples à disposer
d’eux-mêmes. les deux grandes puissances (États-unis et urss)
s’opposent, mais soutiennent parfois indépendances pour
affaiblir anciens empires.
La création de l'Etat d'Israël
En 1948, après la Shoah, les Juifs proclament la création de l’État d’Israël en Palestine, avec le soutien des Nations unies. L’ONU avait proposé un partage du territoire entre un État juif et un État arabe. Les Juifs acceptent, mais les Arabes palestiniens et les pays voisins refusent ce plan. Dès le lendemain, plusieurs pays arabes déclarent la guerre à Israël. Israël gagne la guerre et s’agrandit par rapport au plan initial. Environ 700 000 Palestiniens fuient ou sont expulsés de leurs terres : c’est la "nakba", la catastrophe pour les Palestiniens. Ce conflit marque le début d’une longue guerre entre Israéliens et Palestiniens, toujours non résolue aujourd’hui.
----------------YOUTUBE-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le monde bipolaire de la guerre froide
1. Un monde divisé en deux blocs
----------------YOUTUBE-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
À la fin de la Seconde Guerre mondiale, deux superpuissances dominent le monde : les États-Unis et l’Union soviétique. Elles ont des idéologies opposées : le capitalisme libéral pour les États-Unis, le communisme pour l’URSS. Rapidement, une rivalité s’installe entre les deux, marquant le début de la guerre froide.

Carte des deux blocs 1945-91
Le monde se divise alors en deux blocs : le bloc de l’Ouest, dirigé par les États-Unis et leurs alliés (France, Royaume-Uni, Allemagne de l’Ouest, etc.), et le bloc de l’Est, sous l’influence de l’URSS (pays d’Europe de l’Est comme la Pologne, la Hongrie ou la RDA). Chaque bloc s’organise militairement : l’OTAN est créée en 1949 pour les pays occidentaux, le Pacte de Varsovie en 1955 pour les pays communistes.
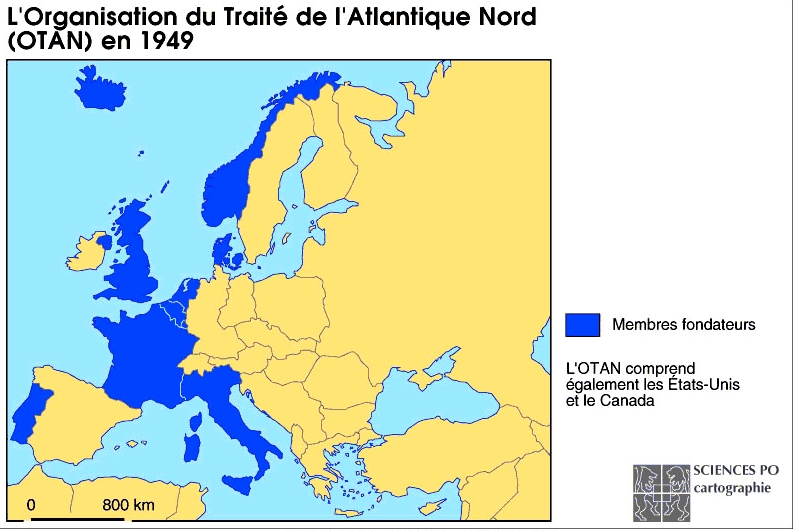
OTAN - 1949
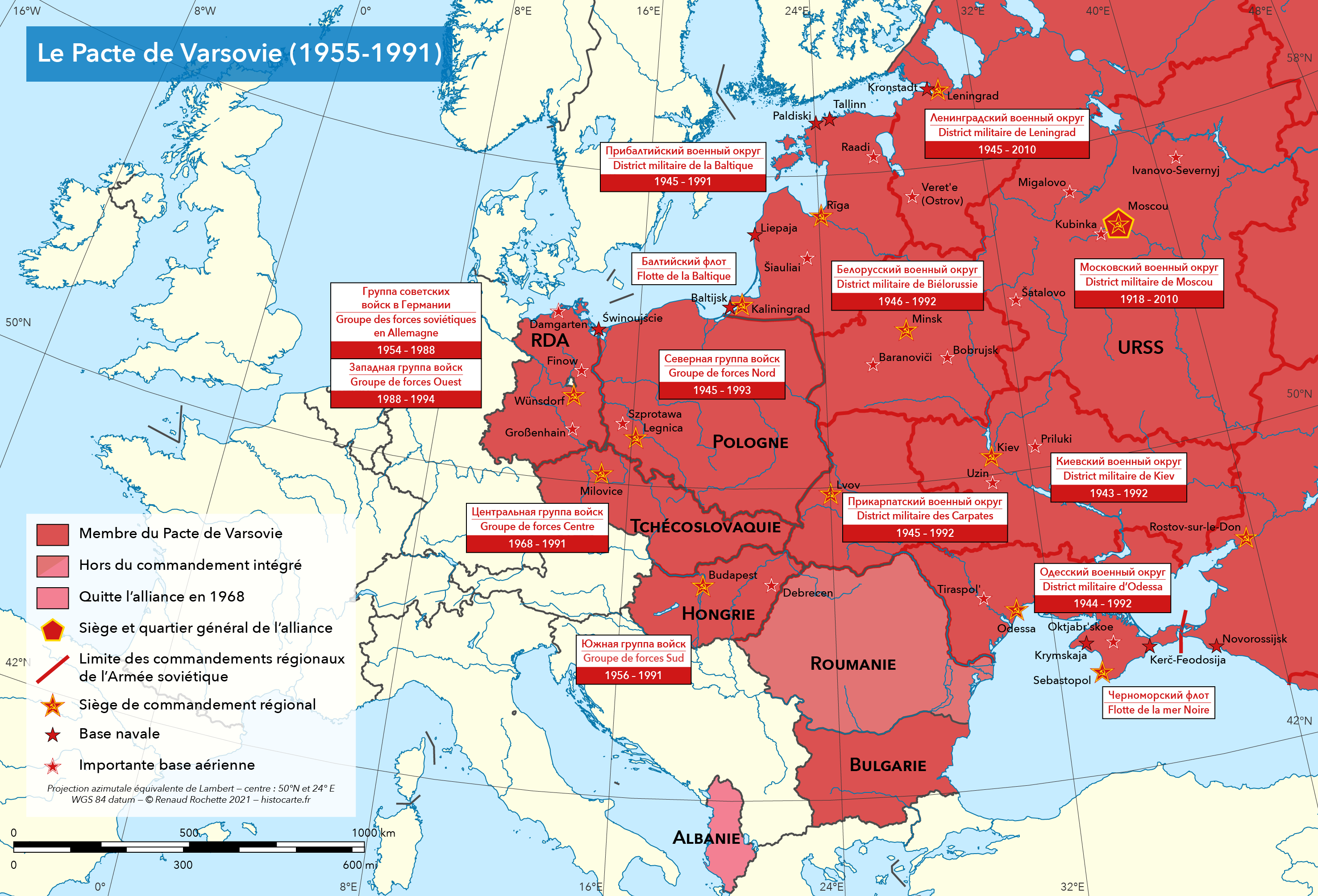
Pacte de Varsovie
Mots clefs
Guerre froide
Période de tensions (1947-1991) entre les États-Unis et
l’URSS sans affrontement direct, marquée par une forte
rivalité idéologique, militaire et économique.
Bloc
Ensemble de pays unis autour d’une puissance dominante,
partageant une idéologie commune.
2. Une guerre sans affrontement direct
La guerre froide ne donne pas lieu à un affrontement militaire direct entre les États-Unis et l’URSS, car chacun possède l’arme nucléaire, ce qui rend une guerre mondiale trop dangereuse. C’est l’équilibre de la terreur. La guerre se joue donc autrement : par la propagande, l’espionnage, la course à l’armement, et la conquête spatiale.
Des images au service d'idéologies concurentes

Captain America - une guerre idéologique
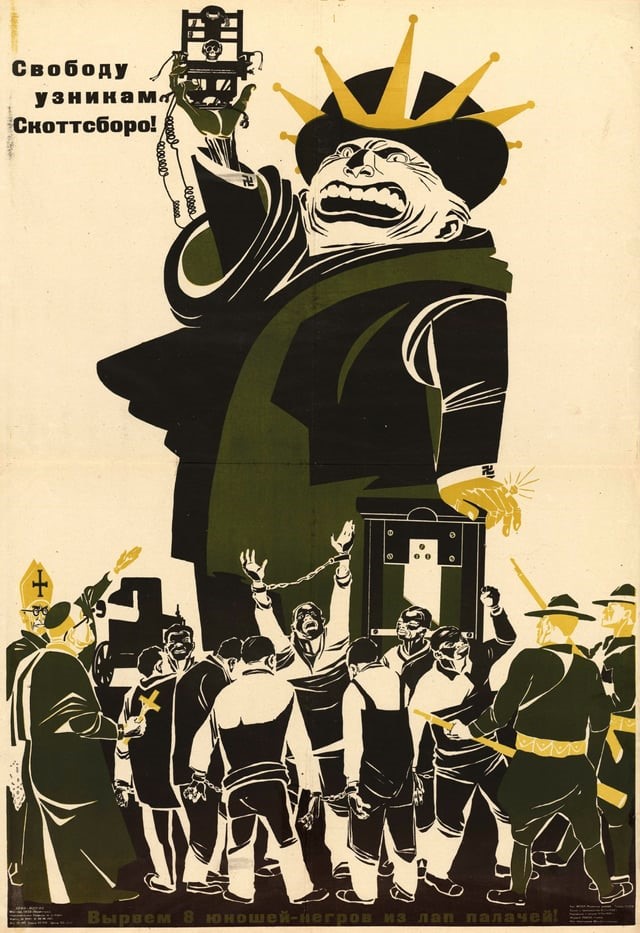
Affiche de propagande anti-américaine de l'URSS
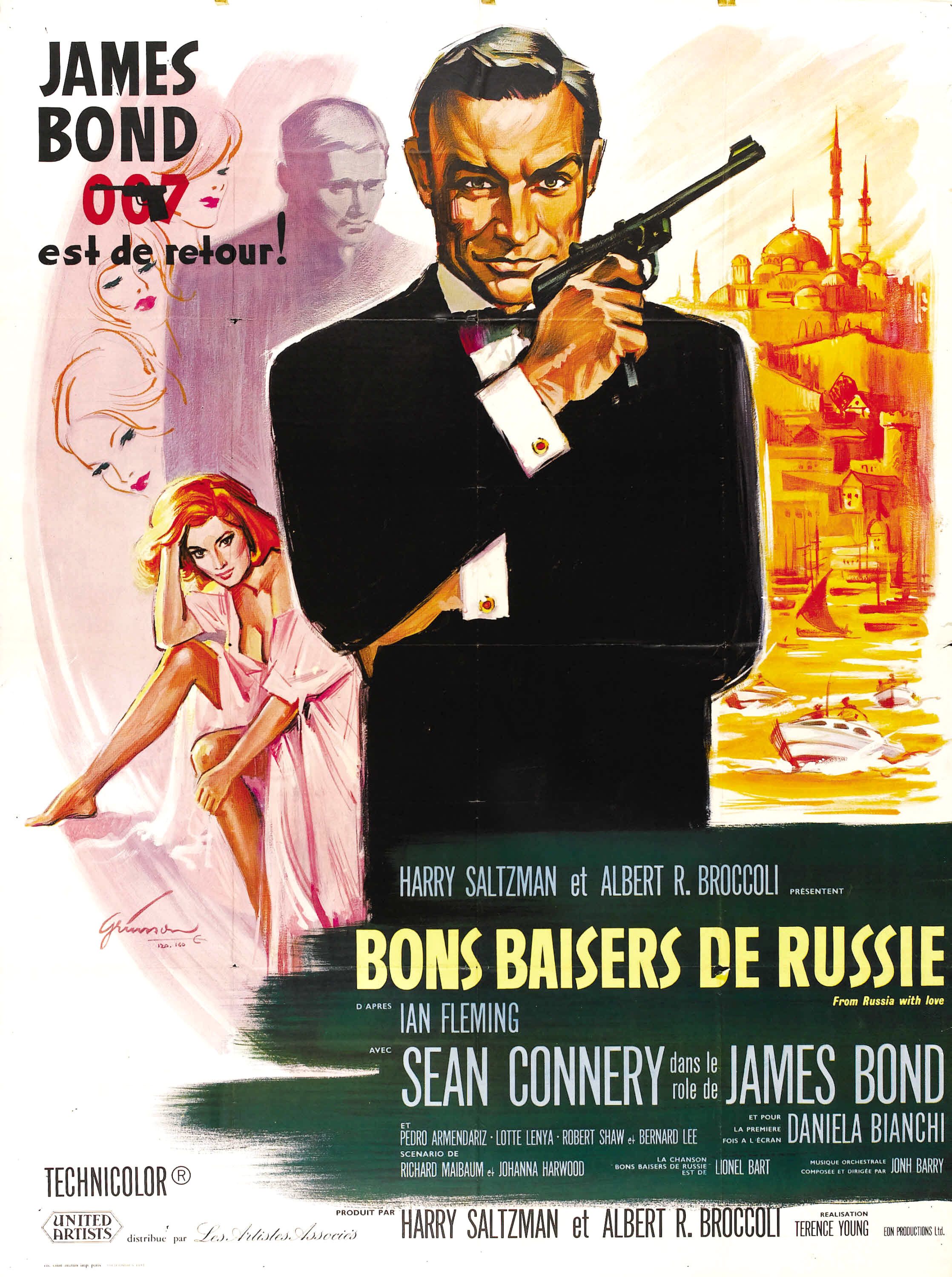
L'espion Anglais contre l'URSS
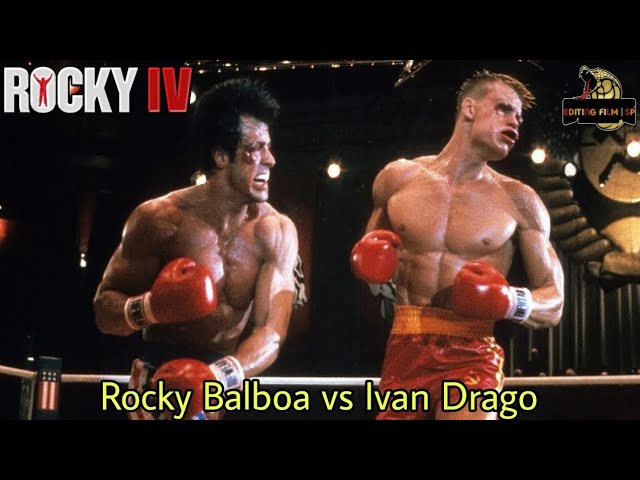
Rocky IV - Le combat entre les Etats Unis et l'URSS

Sputnik, le premier satellite en 1957

Yuri Gagarin, le premier homme dans l'espace

La mission Apollo 11, Niel Amstrong, le premier homme sur la Lune
Les conflits ont lieu indirectement, dans des pays tiers : c’est ce qu’on appelle des conflits par pays interposés. Par exemple, la guerre de Corée (1950-1953) oppose le Nord communiste (soutenu par la Chine et l’URSS) et le Sud (soutenu par les États-Unis). Idem pour la guerre du Vietnam ou la guerre d’Afghanistan.


Guerre du Vietnam - 1955-75
La guerre du Vietnam a eu lieu de 1955 à 1975. Elle opposait le Nord-Vietnam, communiste, au Sud-Vietnam, soutenu par les États-Unis. Les combats étaient très violents, avec beaucoup de destructions et de morts. Malgré l’aide des Américains, le Sud a perdu et le Vietnam est devenu un pays communiste. Cette guerre a laissé de grandes traces dans les esprits et la société.
La conquête de l'espace
Pendant la guerre froide, les États-Unis et l’URSS se sont
livrés à une course à la conquête de l’espace. Chacun voulait
prouver sa supériorité technologique et idéologique.
L’URSS prend de l’avance en 1957 en lançant Spoutnik, le
premier satellite artificiel, puis en envoyant le premier
homme dans l’espace, Youri Gagarine, en 1961.
En réponse, les États-Unis investissent massivement dans la
NASA. En 1969, ils remportent une victoire symbolique en
envoyant les premiers hommes sur la Lune avec la mission
Apollo 11.
Cette rivalité pousse les deux puissances à de nombreuses
avancées scientifiques.
Dans les années 1970, la tension diminue et la coopération
commence, notamment avec la mission Apollo-Soyouz en 1975.
----------------YOUTUBE-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------YOUTUBE-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mots clefs
Équilibre de la terreur
Situation où deux puissances nucléaires s’empêchent
mutuellement d’attaquer de peur d’être détruites.
Conflit indirect
Guerre menée par des alliés ou des pays interposés au lieu
d’un affrontement direct entre les deux grandes puissances.
----------------YOUTUBE-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le mouvement hippie est apparu dans les années 1960, principalement aux États-Unis, en réaction à la guerre du Vietnam, à la société de consommation et aux règles strictes de la société. Les hippies prônaient des valeurs de paix, d’amour libre, de tolérance et de retour à la nature. Ils rejetaient l’autorité, vivaient souvent en communautés autogérées et expérimentaient un mode de vie alternatif. Leur culture se manifestait à travers la musique (comme celle de Woodstock), les vêtements colorés, l’art psychédélique et parfois l’usage de drogues. Ce mouvement a profondément influencé la société, en ouvrant la voie à des débats sur l’écologie, la liberté individuelle et les droits civiques.

 Video Lumni
Video Lumni
Le festival de Woodstock a eu lieu en août 1969 à Bethel, dans l'État de New York. Il a rassemblé près de 500 000 personnes venues célébrer la paix, la musique et la liberté. Cet événement est devenu un symbole du mouvement hippie et de la contre-culture des années 60. Pendant trois jours, de grands artistes comme Jimi Hendrix, Janis Joplin ou The Who se sont produits dans une ambiance de solidarité et de non-violence. Malgré le chaos logistique, Woodstock reste un moment historique marquant l’esprit de révolte et d’espoir d’une génération.
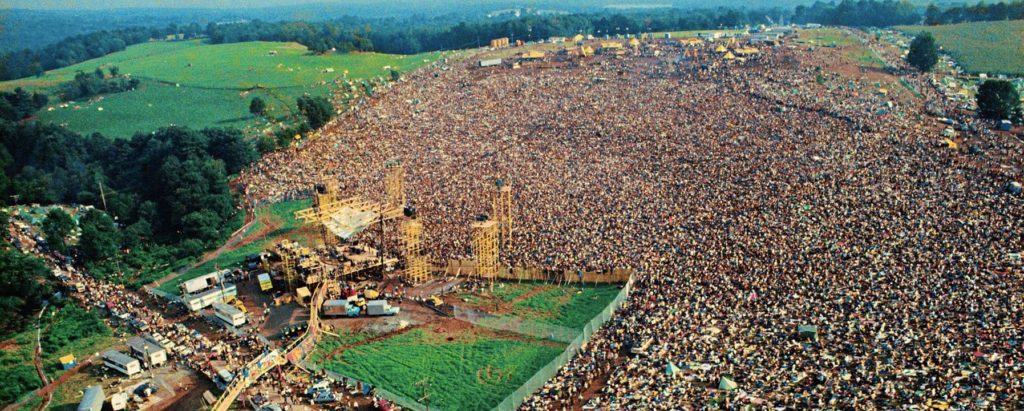
 Jimi Hendrix - The Star Spangled Banner [ National Anthem
] ( Live at Woodstock 1969 )
Jimi Hendrix - The Star Spangled Banner [ National Anthem
] ( Live at Woodstock 1969 )  The Who - My Generation, Live at Woodstock
The Who - My Generation, Live at Woodstock autres
 Bob Dylan - All Along the Watchtower (Official Audio)
Bob Dylan - All Along the Watchtower (Official Audio)
 Bob Dylan - The Times They Are A-Changin' (Official Audio)
Bob Dylan - The Times They Are A-Changin' (Official Audio)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Les crises de la guerre froide
Plusieurs crises marquent la guerre froide. Berlin est une ville emblématique de cette division : en 1948, le blocus de Berlin par l’URSS est contourné par un pont aérien mis en place par les États-Unis. En 1961, l’URSS construit le mur de Berlin pour empêcher les Allemands de l’Est de fuir vers l’Ouest.


Le mur de Berlin
La crise de Cuba, en 1962, est la plus grave. L’URSS installe des missiles nucléaires à Cuba, menaçant directement les États-Unis. Après plusieurs jours de tension extrême, un compromis est trouvé : l’URSS retire ses missiles, en échange d’une promesse américaine de ne pas envahir Cuba. Cette crise montre à quel point le monde était proche d’une guerre nucléaire.
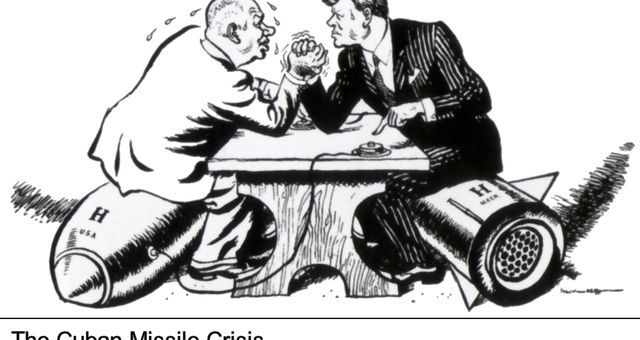
caricature de Nikita Khrouchtchev et John Fitzgerald Kennedy
----------------YOUTUBE-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mots clefs
Mur de Berlin
Mur construit en 1961 séparant Berlin-Ouest et Berlin-Est,
symbole de la division du monde.
Crise de Cuba
Tension extrême entre les États-Unis et l’URSS en 1962,
provoquée par l’installation de missiles soviétiques à Cuba.
4. La fin du monde bipolaire
Dans les années 1980, l’URSS est en crise. Le régime communiste est affaibli par des difficultés économiques et une contestation croissante. Mikhaïl Gorbatchev, au pouvoir à partir de 1985, lance des réformes : la perestroïka (restructuration économique) et la glasnost (plus de liberté d’expression).

Mikhail Gorbatchev et Ronald Reagan
En 1989, les régimes communistes d’Europe de l’Est s’effondrent. Le mur de Berlin tombe en novembre, marquant la fin symbolique de la guerre froide. En 1991, l’URSS disparaît officiellement. Les États-Unis restent la seule superpuissance : c’est la fin du monde bipolaire.


le 11 Novembre 1989 - La chute du mur de Berlin
Mots clefs
Perestroïka
Réforme économique menée par Gorbatchev pour moderniser
l’URSS.
Glasnost
Politique d’ouverture et de transparence dans les médias et
la vie politique soviétique.
Les pays non-alignés
Les pays non-alignés sont des États qui ont choisi de ne pas
rejoindre l’un des deux grands blocs pendant la guerre froide
: le bloc de l’Ouest (mené par les États-Unis) et le bloc de
l’Est (mené par l’URSS).
Ce mouvement est né dans les années 1950 et a été
officiellement lancé lors de la conférence de Bandung en 1955,
puis confirmé par la conférence de Belgrade en 1961. Les
leaders comme Nehru (Inde), Nasser (Égypte) et Tito
(Yougoslavie) en sont les figures principales.
Leur objectif était de préserver leur indépendance politique
et de défendre la paix, la décolonisation et le développement.
La plupart de ces pays étaient situés en Afrique, en Asie ou
en Amérique latine. Bien qu’ils affirment leur neutralité,
certains se rapprochaient parfois d’un camp pour des raisons
économiques ou militaires.
Le mouvement des non-alignés reste un symbole d’émancipation
face aux grandes puissances.
----------------YOUTUBE-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------YOUTUBE-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. Le monde après la guerre froide
Après 1991, le monde devient multipolaire, c’est-à-dire que plusieurs grandes puissances influencent les relations internationales : les États-Unis, l’Union européenne, la Chine, la Russie. De nouvelles puissances régionales apparaissent, et de nouveaux enjeux remplacent la confrontation Est-Ouest : terrorisme, écologie, cybersécurité, inégalités économiques…
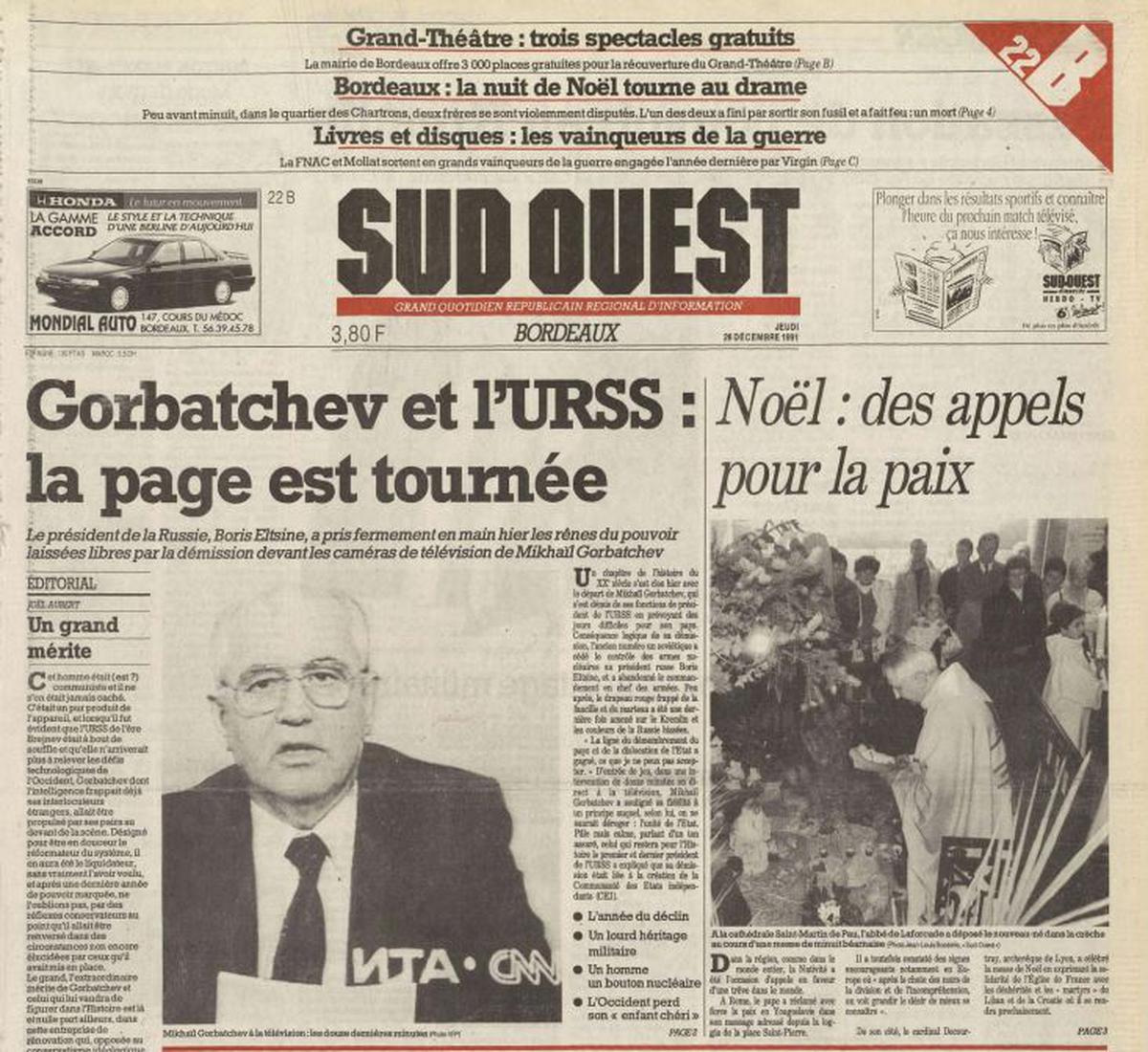

La fin du monde bipolaire ne signifie pas la fin des tensions : des conflits continuent dans plusieurs régions du globe, et la rivalité entre grandes puissances demeure sous d'autres formes. La guerre froide reste donc une période clé pour comprendre le monde actuel.
Mots clefs
Monde multipolaire
Monde dans lequel plusieurs puissances régionales ou
mondiales exercent une influence.
Superpuissance
Pays qui possède une très grande influence à l’échelle
mondiale, sur les plans économique, militaire et culturel.
Le projet européen de 1950 à 1989
1. La naissance de la construction européenne
----------------YOUTUBE-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Après la Seconde Guerre mondiale, l’Europe est affaiblie. Les États européens veulent éviter de nouveaux conflits. L’idée d’une union entre les pays d’Europe commence à se développer, notamment pour garantir la paix, favoriser la reconstruction économique et faire face à la menace soviétique.
En 1950, le ministre français Robert Schuman propose de mettre en commun la production de charbon et d’acier entre la France et l’Allemagne. Cette proposition donne naissance à la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier (CECA) en 1951, avec six pays fondateurs : France, Allemagne de l’Ouest, Italie, Belgique, Pays-Bas et Luxembourg.

Robert Schumann
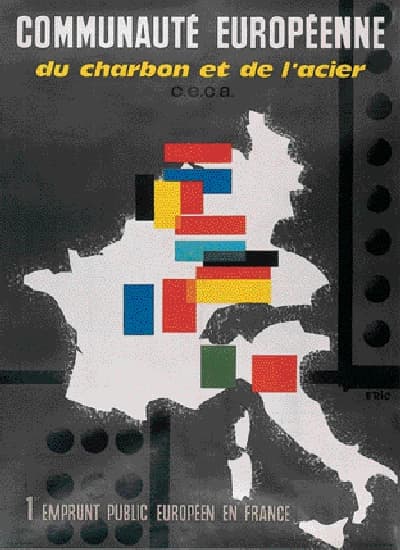
La naissance de la CECA
----------------YOUTUBE-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mots clefs
Robert Schuman
Homme politique français, considéré comme un des pères de
l’Europe, à l’origine de la CECA.
CECA
Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier :
organisation créée en 1951 pour gérer en commun les
industries de base de six pays européens.
2. L’approfondissement de la coopération européenne
En 1957, les six pays signent les traités de Rome, qui créent la Communauté Économique Européenne (CEE) et l’Euratom. L’objectif de la CEE est de créer un marché commun : les marchandises, les capitaux et les personnes peuvent circuler librement entre les pays membres. Progressivement, des politiques communes sont mises en place, comme la Politique Agricole Commune (PAC).

La construction européenne avance par étapes. De nouveaux élargissements ont lieu : le Royaume-Uni, l’Irlande et le Danemark rejoignent la CEE en 1973. Ensuite, la Grèce (1981), puis l’Espagne et le Portugal (1986) deviennent membres à leur tour.
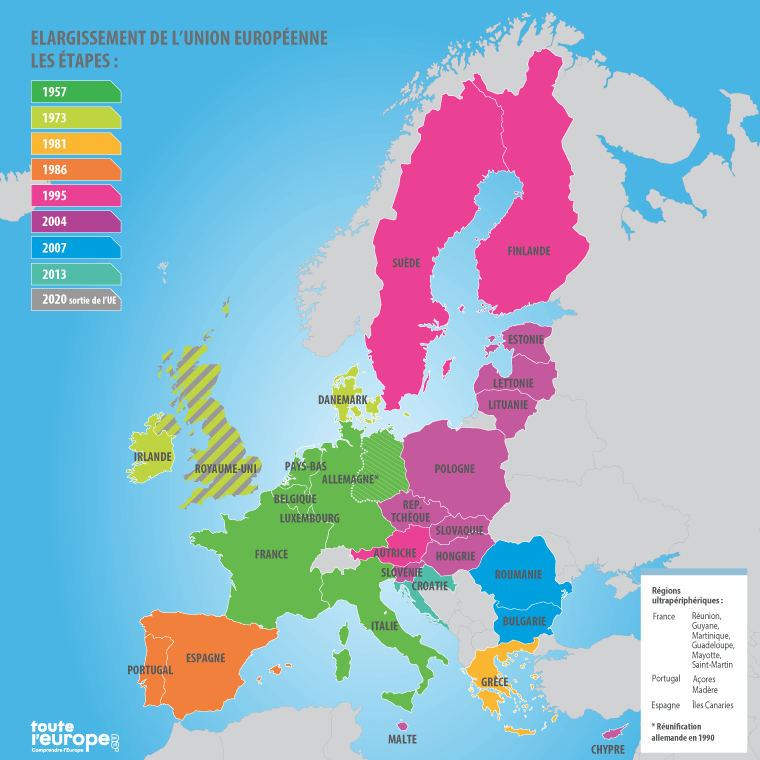
Mots clefs
CEE
Communauté Économique Européenne, créée en 1957 pour
construire un marché commun entre les pays membres.
Politique Agricole Commune (PAC)
Politique mise en place par la CEE pour soutenir
l’agriculture européenne et garantir les revenus des
agriculteurs.
3. Les limites et les critiques du projet européen
Malgré les avancées, la construction européenne rencontre aussi des difficultés. Tous les pays européens ne veulent pas intégrer les mêmes politiques. Le Royaume-Uni, par exemple, reste souvent en retrait de certains projets d’union plus poussée.
Il existe aussi des tensions entre les pays membres : certains craignent de perdre leur souveraineté nationale ou leur identité. D’autres estiment que l’Europe avance trop lentement ou que les institutions européennes ne sont pas assez démocratiques. Ces limites ralentissent certains projets comme l’union politique ou la défense européenne commune.
Mots clefs
Souveraineté
Capacité d’un État à prendre ses décisions sans influence
extérieure.
Institution européenne
Organisme qui fait fonctionner l’Union européenne, comme la
Commission, le Parlement ou le Conseil.
Le monde après 1989
1. La fin de la guerre froide et de l’URSS
En 1989, le mur de Berlin tombe, marquant la fin symbolique de la guerre froide. Cette chute entraîne l’effondrement des régimes communistes en Europe de l’Est. En 1991, l’Union soviétique disparaît, et 15 nouveaux États deviennent indépendants, dont la Russie, l’Ukraine et les pays baltes.
Les États-Unis deviennent alors la seule superpuissance mondiale. Le monde entre dans une nouvelle période : l’ordre bipolaire laisse place à un monde dominé par les États-Unis, parfois qualifié d’unipolaire.
Mots clefs
Unipolaire
Système mondial dominé par une seule grande puissance, ici
les États-Unis après 1991.
2. L’élargissement de la démocratie et de l’économie de marché
Après 1989, de nombreux pays adoptent la démocratie et l’économie de marché. En Europe de l’Est, les anciens pays communistes abandonnent les partis uniques et organisent des élections libres. Ils privatisent leurs économies, souvent avec l’aide de l’Union européenne ou du FMI.
De nombreux pays d’Europe centrale et orientale rejoignent l’Union européenne dans les années 2000. L’économie mondiale se mondialise encore davantage, avec une forte croissance des échanges commerciaux et financiers.
Mots clefs
Économie de marché
Système économique basé sur la libre entreprise, la
concurrence et la loi de l’offre et de la demande.
3. Les nouveaux déséquilibres et conflits
La fin de la guerre froide ne signifie pas la fin des tensions. De nouveaux conflits apparaissent, souvent liés à des questions ethniques, religieuses ou à des luttes pour le pouvoir. Dans les Balkans, l’ex-Yougoslavie se déchire dans des guerres meurtrières dans les années 1990 (Bosnie, Kosovo...).

Guerre de Bosnie-Herzegovine - 1992
Le terrorisme devient une menace mondiale, surtout après les attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis. En réponse, les États-Unis interviennent en Afghanistan en 2001, puis en Irak en 2003. Ces guerres marquent le début d’une période d’instabilité au Moyen-Orient.

L'attentat des Twin Towers le 11 septembre 2001
Mots clefs
Terrorisme
Usage de la violence pour faire peur et atteindre des
objectifs politiques ou idéologiques.
Guerres des Balkans
Conflits violents dans les années 1990 après l’éclatement de
la Yougoslavie, marqués par des nettoyages ethniques.
4. Les nouveaux défis du XXIe siècle
Le monde du XXIe siècle est marqué par de nouveaux enjeux. Le changement climatique devient un défi majeur, avec des catastrophes naturelles plus fréquentes et une prise de conscience mondiale. La transition énergétique, la protection de la biodiversité et la réduction des émissions de gaz à effet de serre sont devenues prioritaires.
D’autres défis émergent aussi : les migrations, les pandémies, la cybersécurité, les inégalités économiques, et la montée de nouvelles puissances comme la Chine. La coopération internationale devient plus difficile, même si des organisations comme l’ONU ou l’Union européenne tentent d’agir.
Mots clefs
Changement climatique
Modification durable du climat mondial, en grande partie
liée aux activités humaines.
Puissance émergente
Pays dont l’économie et l’influence augmentent rapidement
sur la scène internationale (ex. : Chine, Inde, Brésil).
Thème 3 : Françaises et Français dans une République repensée
Refonder la République (1944-1947)
1. La Libération et la fin de Vichy
----------------YOUTUBE-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Après la libération du territoire français en 1944, la France doit refonder son gouvernement et ses institutions. Le régime de Vichy, qui avait collaboré avec l'Allemagne nazie, est dissous. La France se lance dans une phase de reconstruction, tant sur le plan politique que social. Le gouvernement provisoire, dirigé par le général de Gaulle, assume les pouvoirs exécutifs et législatifs pendant cette période de transition.
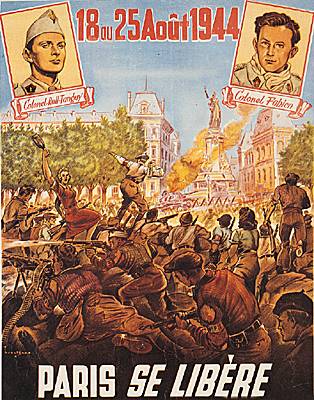
Affiche - La libération de paris
La République est restaurée, mais sur des bases nouvelles, avec l’objectif de réparer les injustices de la guerre et de remettre en place une démocratie solide et durable. De Gaulle est perçu comme le sauveur de la nation, et son autorité est incontestée pendant cette période.

Mots clefs
Régime de Vichy
Gouvernement autoritaire de la France, dirigé par le
maréchal Pétain, pendant l'occupation allemande.
Général de Gaulle
Leader de la France libre et fondateur de la Cinquième
République, il joue un rôle central après la Libération.
2. La mise en place du Gouvernement Provisoire
Le Gouvernement Provisoire de la République Française (GPRF) est formé en 1944 sous la présidence de Charles de Gaulle. Il a pour objectif de restaurer l'ordre républicain et de préparer la reconstruction politique du pays. L'une des premières mesures est de donner le droit de vote aux femmes, qui obtiennent ce droit en 1944.
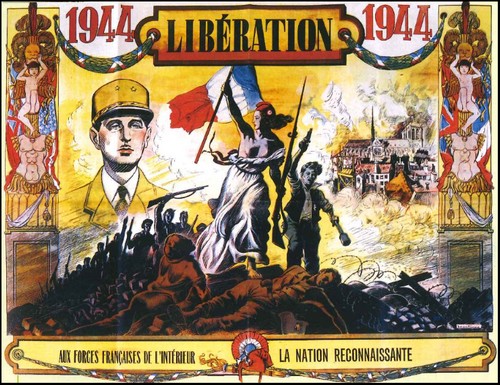
Le GPRF prend des décisions importantes pour réorganiser la France. Cela inclut la nationalisation de nombreuses industries stratégiques (comme les mines et l'électricité), la réforme agraire, et la mise en place de la sécurité sociale. Le projet est de bâtir une société plus juste, en éliminant les inégalités sociales héritées de la période d'avant-guerre.
Mots clefs
GPRF
Gouvernement Provisoire de la République Française, dirigé
par de Gaulle après la Libération, chargé de restaurer la
république.
Sécurité sociale
Système public qui garantit une couverture sanitaire et des
aides sociales pour tous les citoyens.
3. La rédaction de la Constitution de la Quatrième République
----------------YOUTUBE-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
En 1946, une nouvelle Constitution est rédigée afin de remplacer celle de la Troisième République, mise en place avant la guerre. La Quatrième République naît avec un système parlementaire, où le pouvoir exécutif est principalement exercé par le gouvernement, dirigé par un Premier ministre.
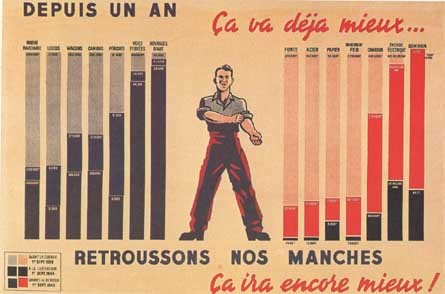
Cette Constitution crée une instabilité politique importante, car le Parlement est dominé par de nombreux partis, ce qui rend difficile la formation de majorités stables. Les gouvernements sont souvent fragiles et changent fréquemment. En dépit de cela, des réformes importantes sont adoptées, comme la décolonisation de l'Indochine et la mise en place d'un plan de reconstruction économique.
Mots clefs
Quatrième République
Période de la République française de 1946 à 1958, marquée
par une instabilité politique et la décolonisation.
Constitution
Ensemble de lois fondamentales qui définissent le
fonctionnement de l'État et de ses institutions.
4. La crise politique et la fin de la Quatrième République
La Quatrième République se trouve confrontée à de multiples crises, notamment la guerre d'Indochine (1946-1954) et la guerre d'Algérie (1954-1962). La décolonisation devient un enjeu majeur et crée des tensions internes. Le système politique, très instable, ne parvient pas à résoudre ces crises.
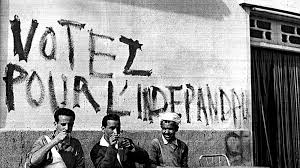
En 1958, après une grave crise politique, de Gaulle revient au pouvoir. Il propose un projet de nouvelle Constitution, qui donnera naissance à la Cinquième République, avec un exécutif plus fort, incarné par le président de la République. La transition vers la Cinquième République marque la fin de la Quatrième République.

Mots clefs
Guerre d'Indochine
Conflit entre la France et les indépendantistes vietnamiens
(1946-1954), qui conduit à la perte de la colonie française
d'Indochine.
Cinquième République
Régime politique actuel de la France, instauré en 1958 sous
Charles de Gaulle, avec un président fort.
La Ve République de 1958 à 1988
----------------YOUTUBE-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. La création de la Ve République (1958)
La Ve République est instaurée en 1958 sous l'impulsion de Charles de Gaulle, après une crise politique majeure liée à la guerre d'Algérie. De Gaulle revient au pouvoir et propose une nouvelle Constitution, qui renforce les pouvoirs du président de la République. La Constitution est approuvée par référendum le 28 septembre 1958.
Ce nouveau régime repose sur un exécutif fort, avec un président doté de pouvoirs importants, notamment en matière de politique étrangère et de défense. La Ve République marque un tournant par rapport à la Quatrième République, qui souffrait d'une grande instabilité gouvernementale.
Mots clefs
Ve République
Régime politique instauré en 1958 sous la présidence de
Charles de Gaulle, avec un exécutif renforcé.
Référendum
Procédure par laquelle le peuple vote directement sur une
question politique ou une loi importante.
2. La présidence de Charles de Gaulle (1958-1969)
Charles de Gaulle devient le premier président de la Ve République en 1958. Son objectif est de stabiliser la France après la crise de la guerre d'Algérie et de renforcer son rôle sur la scène internationale. Il mène une politique de grandeur, cherchant à restaurer l'indépendance de la France, notamment en se détachant de l'influence américaine et en développant la force de dissuasion nucléaire.
Internement, de Gaulle adopte des réformes sociales et économiques importantes. Mais la guerre d'Algérie demeure un lourd fardeau. En 1962, un référendum aboutit à l'indépendance de l'Algérie. Cependant, l'intransigeance de de Gaulle dans les années suivantes le conduit à une crise intérieure. Après les événements de mai 1968, marqués par des manifestations et des grèves générales, il décide de démissionner en 1969.

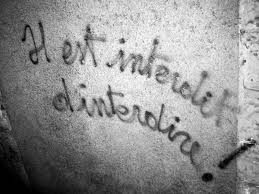

----------------YOUTUBE-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mots clefs
Indépendance de l'Algérie
Processus qui aboutit à la fin de la colonisation française
de l'Algérie en 1962, après une guerre de décolonisation.
Force de dissuasion nucléaire
Stratégie de défense basée sur la possession d'armes
nucléaires, destinées à décourager toute attaque contre un
pays.
3. Les années Pompidou et Giscard d'Estaing (1969-1981)
Après la démission de de Gaulle, Georges Pompidou devient président en 1969. Il continue la politique de modernisation de la France entamée par de Gaulle, mais il met l'accent sur la réconciliation avec l'Allemagne et le développement économique. Sous son mandat, la France connaît une forte croissance économique et une transformation de ses infrastructures. Pompidou meurt en 1974, et Valéry Giscard d'Estaing lui succède.

Georges Pompidou
Giscard d'Estaing, élu en 1974, met en œuvre des réformes sociales libérales, notamment en matière de droits des femmes et de laïcité, comme la légalisation de l'avortement en 1975. Cependant, son mandat est marqué par une crise économique mondiale au milieu des années 1970, avec des problèmes de chômage et de stagnation économique. Cela entraîne une montée du mécontentement, et en 1981, il perd les élections face à François Mitterrand.

Valery Giscard d'Estaing
Mots clefs
Laïcité
Principe selon lequel l'État est séparé des religions,
garantissant la liberté de conscience pour tous.
Croissance économique
Augmentation de la production et des services dans une
économie, souvent mesurée par le PIB.
4. La présidence de François Mitterrand (1981-1988)
François Mitterrand devient président en 1981, marquant le retour de la gauche au pouvoir après des années de domination de la droite. Son mandat débute par une série de réformes ambitieuses, telles que la nationalisation de grandes entreprises et une politique de réduction du temps de travail.
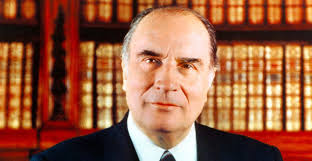
François Mitterand
Son gouvernement met également en place de nombreuses réformes sociales, telles que la retraite à 60 ans et la mise en œuvre de la décentralisation, donnant plus de pouvoirs aux collectivités locales. Sur le plan international, Mitterrand joue un rôle clé dans la construction de l'Union européenne et est un ardent défenseur de l'intégration européenne.
En 1986, la France connaît un tournant avec l'arrivée au pouvoir d'un gouvernement de cohabitation, dirigé par le Premier ministre Jacques Chirac, un rival politique de Mitterrand. Cette cohabitation, bien que difficile, marque l’adaptation de la Ve République à une nouvelle forme de gouvernement avec un président et un Premier ministre issus de partis différents.
Mots clefs
Nationalisations
Processus par lequel l'État prend le contrôle d'entreprises
privées, souvent pour les intégrer dans un secteur public.
Cohabitation
Situation politique où le président de la République et le
Premier ministre sont issus de partis opposés, souvent après
des élections législatives.
Femmes et hommes dans la société des années 1950-1980
----------------YOUTUBE-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. La place des femmes dans la société des années 1950
----------------YOUTUBE-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dans les années 1950, la société française est encore largement marquée par des rôles traditionnels de genre. Les femmes sont principalement cantonnées au foyer, à l'éducation des enfants et à l'entretien du ménage. L'idéal féminin véhiculé par les médias et la publicité est celui de la mère au foyer, dévouée à sa famille.

Le travail des femmes est peu valorisé, et si elles occupent parfois des emplois, ce sont souvent des métiers peu qualifiés et mal rémunérés. De plus, la contraception reste peu accessible, et les femmes ont moins de liberté sur le plan sexuel et reproductif. Les inégalités juridiques et sociales sont encore nombreuses, bien que des réformes aient été lancées pour améliorer leur situation.
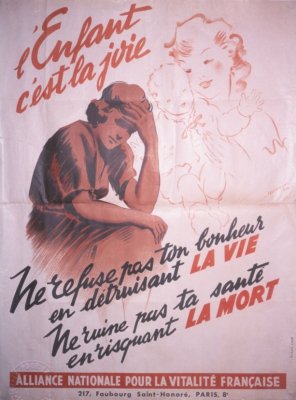
Mots clefs
Mère au foyer
Idéal social et culturel selon lequel les femmes devraient
rester à la maison pour s'occuper des enfants et de la
maison.
Inégalités de genre
Disparités entre les hommes et les femmes dans divers
domaines, comme le travail, l'éducation ou les droits.
2. Les avancées des années 1960 et 1970
Les années 1960 et 1970 marquent une période de changements importants pour les femmes. La révolution sexuelle et les mouvements féministes émergent, avec pour objectif la liberté sexuelle, la contraception, et l'égalité des droits entre les sexes. La légalisation de la pilule contraceptive en 1967 (loi Neuwirth) et la dépénalisation de l'avortement en 1975 (loi Veil) sont des étapes majeures dans la libération des femmes en France.

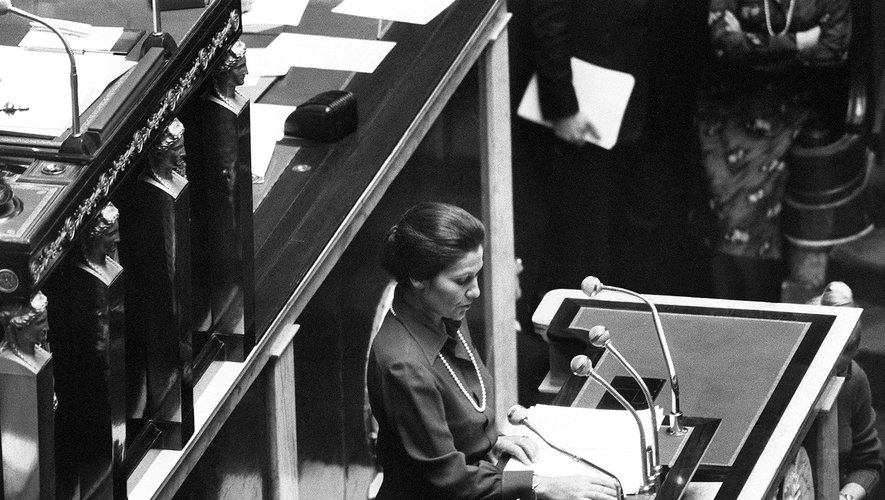
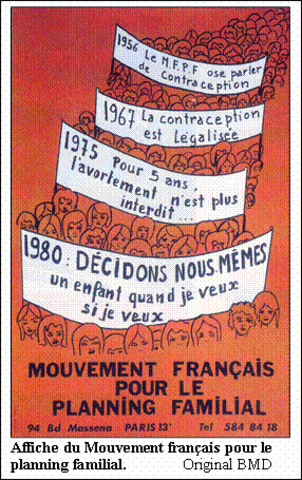
De nombreuses femmes commencent à occuper des postes de plus en plus diversifiés dans le monde du travail. Cependant, elles sont encore confrontées à des stéréotypes et à des obstacles importants, notamment en matière de salaire et d'accès à des postes de direction. Les revendications féministes visent aussi à améliorer les droits de la famille et à combattre les violences conjugales.
Mots clefs
Révolution sexuelle
Mouvement social des années 1960 qui milite pour la
libération des mœurs, la contraception et l'égalité des
sexes.
Loi Veil
Loi de 1975 autorisant l'avortement en France, un tournant
majeur dans les droits des femmes.
3. Les femmes dans le monde du travail et les combats pour l’égalité
Dans les années 1970, les femmes commencent à investir davantage le monde du travail. La montée en puissance du féminisme, notamment avec des figures comme Simone de Beauvoir et Simone Veil, contribue à mettre en lumière les inégalités salariales et professionnelles entre les hommes et les femmes. Les mouvements de revendication pour l’égalité des droits se multiplient, notamment autour de la question de l'égalité salariale et de l’accès aux postes à responsabilités.
Les premières lois sur l'égalité professionnelle sont votées, mais la réalité reste marquée par de fortes discriminations. En outre, le travail des femmes est souvent sous-évalué, notamment dans les secteurs dits « féminisés » comme l'éducation ou la santé. Malgré ces obstacles, les femmes commencent à accéder à des postes dans les administrations, les entreprises et l'enseignement supérieur.
Mots clefs
Féminisme
Mouvement social et politique visant à obtenir l'égalité
entre les sexes, notamment dans le domaine des droits
civiques et professionnels.
Discrimination professionnelle
Inégalités de traitement et d'accès aux postes de travail,
basées sur le genre, la race ou d'autres critères sociaux.
4. L’évolution des mentalités et des rôles sociaux (années 1980)
Les années 1980 marquent un tournant dans les mentalités concernant les rôles des femmes et des hommes dans la société. La libération des mœurs et l’émergence de la parité dans certains domaines, comme la politique, permettent de modifier progressivement les représentations traditionnelles des rôles de genre.
Les femmes s’affirment davantage dans l’espace public, non seulement dans le travail mais aussi dans la culture, la politique et le sport. La parité en politique devient un enjeu, même si les inégalités restent persistantes. Le mouvement féministe continue de se renforcer, notamment avec des revendications autour des violences conjugales et du harcèlement sexuel. Les années 1980 seront ainsi marquées par une réelle évolution des droits des femmes, bien que la parité et l'égalité ne soient pas encore complètement acquises.
Mots clefs
Parité
Principe selon lequel hommes et femmes doivent avoir les
mêmes droits et une représentation égale dans les
institutions publiques.
Harcèlement sexuel
Comportements verbaux ou physiques à connotation sexuelle
non désirée, créant un environnement de travail hostile ou
menaçant.
Ressources Supplémentaires
----------------YOUTUBE-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Les grandes idéologies du XXème siècle
Le communisme
Le communisme est une idéologie politique et économique qui veut créer une société sans classes sociales, où tout le monde serait égal. Dans un système communiste, les richesses, les terres, les usines et les entreprises appartiennent à la collectivité (souvent à l'État) et non à des personnes privées. L’objectif est que chacun travaille selon ses capacités et reçoive selon ses besoins. Le communisme s’oppose au capitalisme, où les richesses appartiennent à des individus ou à des entreprises privées. L’idée vient de penseurs comme Karl Marx au XIXe siècle. Au XXe siècle, plusieurs pays comme l’URSS, la Chine ou Cuba ont adopté des régimes communistes. Mais dans la réalité, ces régimes étaient souvent dirigés par un parti unique avec peu de libertés pour la population. Le communisme a marqué profondément l’histoire du XXe siècle, notamment pendant la guerre froide.
Le léninisme
Le léninisme est une version du communisme développée par Vladimir Lénine, le leader de la Révolution russe de 1917. Il adapte les idées de Karl Marx pour organiser une révolution menée par un parti communiste fort, capable de diriger le peuple. Selon le léninisme, pour réussir à construire une société communiste, il faut un parti unique, discipliné, qui contrôle l’État et guide la classe ouvrière. Lénine pense que la révolution ne peut pas se faire spontanément, mais doit être dirigée par ce parti. Après la révolution, le pouvoir est centralisé et l’économie planifiée par l’État. Le léninisme a influencé l’URSS et d’autres pays communistes au XXe siècle.
Le stalinisme
Le stalinisme est une forme de communisme qui porte le nom de Joseph Staline, chef de l’URSS de 1924 à 1953. Il se caractérise par un pouvoir très centralisé et autoritaire, où Staline contrôlait tout. Sous son régime, l’État contrôlait l’économie, la culture et la société. Le stalinisme utilise la répression : les opposants sont emprisonnés, envoyés au goulag (camps de travail) ou exécutés. La propagande glorifie Staline et le régime. Malgré la terreur, l’URSS devient une grande puissance industrielle et militaire. Le stalinisme est critiqué pour ses violations des droits humains et son manque de libertés. Après la mort de Staline, certains dirigeants soviétiques ont essayé de réformer ce système.
La doctrine Jdanov
La doctrine Jdanov est une théorie politique mise en place par Andreï Jdanov, un dirigeant soviétique, à la fin des années 1940, pendant la guerre froide. Elle divise le monde en deux camps opposés : le camp impérialiste dirigé par les États-Unis, considéré comme agressif et exploitant les peuples, et le camp démocratique, mené par l’URSS, présenté comme protecteur des travailleurs et des peuples opprimés. Cette doctrine sert à justifier la politique étrangère soviétique, en renforçant l’idée d’une lutte mondiale entre le communisme et le capitalisme. Elle influence aussi la culture et les arts, en condamnant tout ce qui est considéré comme « occidental » ou « bourgeois ».
Le socialisme
Le socialisme est une idéologie politique et économique qui cherche à réduire les inégalités entre les riches et les pauvres. Il propose que les richesses et les moyens de production (usines, terres, entreprises) soient partagés plus équitablement, parfois en appartenant à l’État ou à des coopératives. Le but est de garantir à tous l’accès à l’éducation, à la santé, au travail et à une vie digne. Le socialisme défend aussi la solidarité et la justice sociale. Il est né au XIXe siècle, en réaction aux injustices du capitalisme. Il existe plusieurs formes de socialisme : certaines modérées (comme la social-démocratie), d’autres plus radicales (proches du communisme). Aujourd’hui, le socialisme influence encore de nombreux partis politiques et politiques publiques dans le monde.
Les différences entre le communisme et le socialisme
Objectif commun : Les deux veulent réduire les inégalités et défendre la justice sociale.
Propriété :
Socialisme : accepte une certaine propriété privée, mais
veut que les grandes richesses (comme les hôpitaux, transports,
énergie) soient contrôlées par l’État ou partagées.
Communisme : veut supprimer toute propriété privée des
moyens de production, tout appartient à la collectivité.
Méthode :
Socialisme : propose des réformes progressives, souvent
par des lois et la démocratie.
Communisme : prône parfois une révolution pour tout
changer rapidement.
Libertés :
Socialisme : en général, respecte les libertés
individuelles et la démocratie.
Communisme : souvent associé à des régimes autoritaires
dans l’histoire.
En résumé, le communisme est une version plus radicale du socialisme.
L'anarchisme
L’anarchisme est une idéologie politique qui rejette toute forme d’autorité imposée, comme l’État, le gouvernement, la police ou même les chefs d’entreprise. Les anarchistes pensent que les gens peuvent vivre ensemble librement, en s’organisant eux-mêmes sans hiérarchie. Selon eux, les lois, les gouvernements et le pouvoir créent des injustices et des inégalités. Ils défendent la liberté totale, l’égalité, la solidarité et l’autogestion. L’anarchisme est apparu au XIXe siècle avec des penseurs comme Pierre Kropotkine ou Mikhaïl Bakounine. Il a inspiré des mouvements ouvriers, des révolutions et des expériences de communautés sans chefs. Contrairement à ce qu’on pense parfois, l’anarchisme ne veut pas le chaos, mais une société plus juste et libre, sans domination.
Il ne pas confondre l'anarchisme avec l'anomie, l'absence de règles/ lois ni avec le libéralisme.
La social-démocratie
La social-démocratie est une idéologie politique qui cherche à améliorer le capitalisme en le rendant plus juste et humain. Elle accepte l’économie de marché, mais veut que l’État intervienne pour protéger les plus faibles et réduire les inégalités. Par exemple, elle soutient les services publics comme l’école, la santé et la sécurité sociale. La social-démocratie défend aussi les droits des travailleurs, comme le droit de grève et la protection contre le chômage. Elle privilégie la démocratie, les élections libres et le respect des libertés individuelles. Cette idéologie est née au XIXe siècle et s’est développée surtout en Europe au XXe siècle. Aujourd’hui, plusieurs partis politiques en Europe se réclament de la social-démocratie. Elle cherche un équilibre entre liberté économique et justice sociale.
Le capitalisme
Le capitalisme est un système économique dans lequel les entreprises, les terres et les richesses appartiennent à des personnes privées, et non à l’État. Dans ce système, chacun peut créer une entreprise, investir de l’argent, faire du profit et posséder des biens. L’économie est organisée autour du marché : les prix sont fixés par l’offre et la demande. Le capitalisme encourage la liberté d’entreprendre, la concurrence et l’innovation. Il est souvent associé à la démocratie libérale, comme aux États-Unis ou en Europe de l’Ouest. Cependant, il peut aussi créer des inégalités, car certains s’enrichissent beaucoup plus que d’autres. Pendant la guerre froide, le capitalisme s’opposait au communisme, deux systèmes très différents. Aujourd’hui, la plupart des pays ont une économie capitaliste, parfois avec un rôle important de l’État.
Le libéralisme
Le libéralisme est une idéologie politique et économique qui défend la liberté individuelle. En politique, il soutient la démocratie, la liberté d’expression, la liberté de religion et l’égalité devant la loi. En économie, le libéralisme veut que l’État intervienne le moins possible : les entreprises doivent être libres de produire, vendre et fixer leurs prix. Le libéralisme s’oppose aux systèmes autoritaires ou trop contrôlés, comme le communisme. Il est né au XVIIIe siècle, avec des penseurs comme John Locke ou Adam Smith. Au XIXe siècle, il inspire de nombreuses réformes en Europe. Aujourd’hui, le libéralisme reste très influent, surtout dans les pays occidentaux. Il peut exister sous différentes formes, parfois avec plus de régulation pour limiter les inégalités.
La doctrine Truman
La doctrine Truman est une politique américaine annoncée en 1947 par le président Harry S. Truman. Son but était de contenir l’expansion du communisme dans le monde, surtout en Europe et au Moyen-Orient. Truman a promis d’aider financièrement et militairement les pays menacés par les régimes communistes, comme la Grèce et la Turquie. Cette doctrine marque le début de la politique de « containment » (endiguement) des États-Unis pendant la guerre froide. Elle a conduit à un engagement plus fort des États-Unis dans les affaires internationales pour lutter contre l’influence soviétique. La doctrine Truman est un symbole de l’opposition entre le bloc capitaliste dirigé par les États-Unis et le bloc communiste mené par l’URSS.
Le maccarthysme
Le maccarthysme est un mouvement politique aux États-Unis dans les années 1950, nommé d’après le sénateur Joseph McCarthy. Il consiste en une chasse aux supposés communistes qui vivraient et travailleraient secrètement dans le pays. Pendant cette période, beaucoup de personnes ont été accusées sans preuves solides, parfois perdu leur emploi ou leur réputation à cause de ces soupçons. Le maccarthysme reflète la peur du communisme qui régnait pendant la guerre froide. Cette période est souvent critiquée pour avoir violé les droits humains et la liberté d’expression. Finalement, le mouvement a perdu de son influence quand ses excès ont été dénoncés.
Le nationalisme
Le nationalisme est une idéologie qui met en avant l’amour et la fierté pour son pays, sa culture et son peuple. Les nationalistes veulent défendre leur identité, leur langue et leurs traditions face à ce qu’ils perçoivent comme des menaces étrangères. Ils pensent que leur nation doit être souveraine, c’est-à-dire libre de décider seule de son avenir, sans intervention d’autres pays. Le nationalisme peut renforcer l’unité d’un peuple, mais parfois il pousse à exclure ou rejeter les autres. Dans l’histoire, le nationalisme a souvent joué un rôle important dans les luttes pour l’indépendance des pays. Cependant, il a aussi parfois mené à des conflits, voire à des guerres, quand il devient trop extrême.
Le populisme
Le populisme est une manière de faire de la politique qui prétend défendre le « peuple » contre les « élites » ou les « grands groupes » jugés corrompus ou déconnectés. Les dirigeants populistes utilisent souvent un langage simple et direct pour toucher les gens ordinaires. Ils promettent de résoudre rapidement les problèmes économiques, sociaux ou politiques. Le populisme peut se retrouver à droite comme à gauche, et prend souvent des formes très différentes selon les pays. Parfois, il critique la démocratie représentative et peut encourager un pouvoir fort. Le populisme peut mobiliser beaucoup de monde, mais il est aussi critiqué parce qu’il peut simplifier les problèmes et diviser la société.
Le poujadisme
Le poujadisme est un mouvement politique français né dans les années 1950, fondé par Pierre Poujade. Il défend surtout les petits commerçants, artisans et agriculteurs, qui se sentent oubliés et écrasés par les impôts et les grandes entreprises. Le poujadisme critique les élites politiques et les institutions, et dénonce ce qu’il appelle la « politique des privilégiés ». Ce mouvement utilise un langage simple et populaire pour mobiliser ses partisans. Il est souvent associé à un discours protestataire, anti-establishment et parfois conservateur. Le poujadisme a connu un grand succès aux élections législatives de 1956, mais il a rapidement perdu de son influence ensuite. Ce mouvement est un exemple important de contestation sociale dans la France d’après-guerre.
Les mouvements d'extrême droite abordés au programme
Les ligues d’extrême droite
Les ligues d’extrême droite sont des groupes politiques ou paramilitaires qui apparaissent surtout en Europe au début du XXe siècle. Elles défendent des idées nationalistes, autoritaires et souvent racistes. Ces ligues veulent un État fort, rejettent la démocratie parlementaire et s’opposent aux communistes et aux socialistes. Elles utilisent parfois la violence contre leurs adversaires politiques. En France, par exemple, des ligues comme l’Action française ou les Croix-de-Feu ont joué un rôle important avant la Seconde Guerre mondiale. Ces mouvements critiquent aussi souvent la société moderne et veulent revenir à des valeurs traditionnelles. Après la guerre, beaucoup ont disparu ou se sont transformés.
Le fascisme
Le fascisme est une idéologie politique autoritaire et nationaliste apparue au début du XXe siècle, notamment en Italie avec Mussolini. Il prône un État très fort, dirigé par un seul chef, et refuse la démocratie et les libertés individuelles. Le fascisme veut unir la nation autour d’une idée de puissance, d’ordre et de discipline. Il rejette le communisme, le socialisme et le libéralisme, et utilise souvent la violence contre ses opposants. Le régime fasciste contrôle les médias, l’éducation et la société pour maintenir son pouvoir. Pendant les années 1920 et 1930, le fascisme s’est étendu à d’autres pays, comme l’Allemagne avec le nazisme.
Le nazisme
Le nazisme est une idéologie politique extrême née en Allemagne dans les années 1920, portée par Adolf Hitler et son parti, le Parti national-socialiste des travailleurs allemands (NSDAP). C’est une forme de fascisme, mais avec des idées racistes très fortes. Le nazisme défend la supériorité de la « race aryenne » et veut éliminer ceux qu’il considère comme inférieurs, notamment les Juifs, les Roms ou les handicapés. Ce régime rejette la démocratie, contrôle tous les aspects de la vie et utilise la violence pour imposer ses idées. Le nazisme a conduit à la Seconde Guerre mondiale et à l’Holocauste, où des millions de personnes ont été tuées. Après la guerre, cette idéologie a été condamnée dans le monde entier.
Le néo-nazisme
Le néonazisme est un mouvement qui reprend les idées du nazisme d’Hitler, mais apparu après la Seconde Guerre mondiale. Les néonazis partagent des idées racistes, antisémites et extrémistes, et ils rejettent la démocratie. Ils glorifient souvent le régime nazi et utilisent des symboles comme la croix gammée. Ce mouvement est interdit dans de nombreux pays car il promeut la haine, la violence et la discrimination. Les néonazis organisent parfois des groupes violents ou des manifestations, ce qui inquiète les autorités. Leur idéologie est rejetée par la majorité des sociétés modernes, qui défendent les droits humains et l’égalité.
Le monarchisme au XXe siècle
Le monarchisme au XXe siècle est un courant politique qui soutient la monarchie, c’est-à-dire un régime où un roi ou une reine gouverne. Même si beaucoup de pays sont devenus des républiques, certains monarchistes veulent garder ou restaurer la monarchie, estimant qu’elle garantit la stabilité, la tradition et l’unité nationale. Dans certains pays, comme en Espagne ou en Grande-Bretagne, la monarchie continue d’exister, souvent sous une forme constitutionnelle où le roi a peu de pouvoir réel. Dans d’autres pays, des mouvements monarchistes ont tenté de revenir au pouvoir, parfois avec des idées très conservatrices. Le monarchisme reste donc un courant politique minoritaire mais actif dans plusieurs régions du monde.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Les questions qui reviennent tout le temps!
Pourquoi y a t-il eut une première guerre mondiale ?
La Première Guerre mondiale a eu lieu à cause de tensions entre plusieurs pays, liées à des rivalités territoriales, des alliances militaires, des ambitions politiques, et des conflits économiques. L’assassinat de l’archiduc François-Ferdinand d’Autriche a été le déclencheur qui a fait basculer ces tensions en guerre.
Quelles sont les conséquences de la première guerre mondiale ?
La Première Guerre mondiale a eu des conséquences majeures. Elle a causé la mort de millions de personnes et la destruction de nombreuses villes et infrastructures. Sur le plan politique, plusieurs grands empires, comme l’Empire austro-hongrois, l’Empire russe et l’Empire ottoman, ont disparu, ce qui a entraîné la création de nouveaux pays et le redécoupage des frontières en Europe. Le traité de Versailles, signé en 1919, a imposé de lourdes réparations à l’Allemagne et limité son armée, ce qui a créé un fort ressentiment. Ces conditions difficiles ont préparé le terrain pour la Seconde Guerre mondiale quelques années plus tard.
Pourquoi y a t-il eu une révolution Russe en 1917 ?
La révolution russe de 1917 est arrivée parce que le peuple était très mécontent du gouvernement du tsar Nicolas II. La Russie traversait de grosses difficultés : la pauvreté était grande, les conditions de travail et de vie étaient très dures, et la guerre (la Première Guerre mondiale) faisait souffrir le pays. Les soldats revenaient blessés ou mouraient, et beaucoup de Russes n’avaient pas assez à manger. Ce mécontentement a poussé le peuple à se révolter pour changer le gouvernement et obtenir plus de justice et de meilleures conditions de vie.
Pourquoi le fascisme est né ?
Le fascisme est né après la Première Guerre mondiale, surtout en Italie, à cause du chaos économique, social et politique. Beaucoup de gens étaient frustrés par la pauvreté, le chômage, et la peur du communisme. Le fascisme promettait de restaurer l’ordre, la fierté nationale, et la puissance du pays, souvent en utilisant un pouvoir fort et autoritaire. Les leaders fascistes, comme Mussolini, ont profité de cette situation pour prendre le contrôle.
Pourquoi le nazisme est né ?
Le nazisme est né en Allemagne après la Première Guerre mondiale, surtout à cause de la crise économique, des humiliations liées au traité de Versailles, et du chômage très élevé. Beaucoup de gens étaient frustrés, cherchaient un responsable à leurs problèmes, et voulaient retrouver la fierté et la puissance de l’Allemagne. Le parti nazi, dirigé par Adolf Hitler, a utilisé ces sentiments en promettant de redresser le pays, de lutter contre les ennemis comme les Juifs et les communistes, et d’imposer un régime autoritaire.
Pourquoi personne en Europe n'a lutté contre le nazisme avant la seconde guerre mondiale ?
Avant la Seconde Guerre mondiale, beaucoup de pays en Europe n’ont pas vraiment lutté contre le nazisme parce qu’ils voulaient éviter une nouvelle guerre après la Première Guerre mondiale. Ils espéraient aussi que Hitler se calmerait ou respecterait les règles. Certains pays avaient aussi leurs propres problèmes économiques et politiques et ne voulaient pas intervenir. Enfin, certains dirigeants pensaient que négocier avec l’Allemagne nazie était mieux que de se battre. Cette attitude s’appelle « l’apaisement ».
Il s'est passé quoi en France entre les deux guerres ?
Entre les deux guerres, la France a connu des changements importants. Après la Première Guerre mondiale, le pays était encore marqué par les destructions et les pertes humaines. L’économie a essayé de se reconstruire, mais la crise de 1929 a aussi frappé la France, provoquant chômage et difficultés. Sur le plan politique, la France a connu plusieurs gouvernements qui changeaient souvent, avec des tensions entre droite et gauche. Des mouvements sociaux et syndicats se sont renforcés, et en 1936, le Front populaire, une coalition de partis de gauche, a gagné les élections et mis en place des réformes comme les congés payés et la réduction du temps de travail. En même temps, la montée des tensions en Europe, notamment avec l’Allemagne nazie, inquiétait beaucoup le pays.
Pourquoi la seconde guerre mondiale a éclaté ?
La Seconde Guerre mondiale a éclaté en 1939 parce que l’Allemagne nazie, dirigée par Hitler, a voulu conquérir des territoires et étendre son pouvoir. En particulier, l’Allemagne a envahi la Pologne le 1er septembre 1939. Cela a poussé la France et le Royaume-Uni à déclarer la guerre à l’Allemagne. Cette guerre était aussi le résultat des tensions non résolues après la Première Guerre mondiale, des ambitions de plusieurs pays, et des échecs des tentatives de paix comme l’apaisement.
Pourquoi Hitler a attaqué la Russie ?
Hitler a attaqué la Russie en 1941 parce qu’il voulait conquérir de vastes territoires à l’Est pour donner plus de « espace vital » (Lebensraum) au peuple allemand. Il considérait aussi l’Union soviétique, dirigée par les communistes, comme un ennemi idéologique dangereux. Cette attaque faisait partie de son plan pour dominer l’Europe et éliminer ce qu’il voyait comme des menaces à son pouvoir.
Pourquoi Hitler s'est allié au Japon ?
Hitler s’est allié au Japon parce que les deux pays avaient des intérêts communs : ils voulaient étendre leur pouvoir et leurs territoires, et ils étaient ennemis des mêmes pays, comme les États-Unis, la Grande-Bretagne et l’Union soviétique. Cette alliance, appelée l’Axe, leur permettait de s’entraider militairement et politiquement pendant la guerre.
Est ce que les pays alliés connaissaient l'existence des camps de la mort ?
Au début, les pays alliés ne savaient pas exactement ce qui se passait dans les camps de la mort nazis. Ils avaient des informations partielles et des rumeurs sur les persécutions et les massacres, mais la vérité complète est devenue claire surtout vers la fin de la guerre, grâce aux témoignages de survivants et aux documents retrouvés après la libération des camps.
Qui sont toutes les populations déportées ?
Les populations déportées par les nazis étaient très diverses. Les principales victimes étaient les Juifs, ciblés pour être exterminés dans l’Holocauste. Mais il y avait aussi d’autres groupes persécutés et déportés, comme les Tsiganes (Roms), les prisonniers politiques, les homosexuels, les handicapés, les résistants, les Slaves (notamment Polonais et Russes), et d’autres minorités. Tous étaient victimes de discrimination, de violences, et souvent de mort dans les camps.
Quelles ont été les conséquences de la seconde guerre mondiale ?
La Seconde Guerre mondiale a eu de lourdes conséquences. Elle a causé la mort de dizaines de millions de personnes et des destructions massives en Europe, en Asie, et ailleurs. Après la guerre, le monde a été profondément changé : l’Allemagne et le Japon ont été occupés, de nouveaux pays ont été créés, et les frontières ont changé. La guerre a aussi conduit à la création de l’ONU pour éviter de futurs conflits. Deux superpuissances, les États-Unis et l’URSS, sont devenues dominantes, ce qui a lancé la Guerre froide. Enfin, le procès des nazis a mis en lumière les crimes contre l’humanité, et beaucoup de pays ont travaillé pour reconstruire la paix et les droits humains.
Est-ce que tous les nazi ont été jugés après la guerre ?
Non, tous les nazis n’ont pas été jugés après la guerre. Seuls les principaux responsables, comme les chefs du régime, ont été jugés lors des grands procès, notamment les procès de Nuremberg. Beaucoup d’autres nazis, surtout ceux qui avaient des rôles moins importants, ont échappé à la justice, soit parce qu’ils se sont cachés, soit parce que les pays n’avaient pas les moyens de les retrouver tous.
Est-ce que Hitler est vraiment mort ?
Oui, Hitler est vraiment mort. Selon les preuves historiques, il s’est suicidé dans son bunker à Berlin en avril 1945, alors que la guerre touchait à sa fin et que les forces alliées approchaient. Son corps a été retrouvé et identifié peu après.
Pourquoi la guerre froide a t-elle commencé ?
La guerre froide a commencé parce que, après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis et l’Union soviétique étaient les deux superpuissances mondiales, mais elles avaient des idéologies très différentes : le capitalisme et la démocratie pour les États-Unis, le communisme pour l’URSS. Elles se méfiaient beaucoup l’une de l’autre et cherchaient à étendre leur influence dans le monde. Cette rivalité a créé des tensions politiques, militaires et économiques sans qu’il y ait de guerre directe entre elles.
Comment est-ce que l'URSS et les Etats-Unis ont fait cette guerre froide ?
Pendant la guerre froide, l’URSS et les États-Unis se sont affrontés sans combat direct. Ils ont surtout utilisé la course aux armements, développant des armes nucléaires pour se menacer mutuellement. Ils ont aussi rivalisé sur le plan économique et technologique, notamment avec la conquête de l’espace. Chacun soutenait des pays ou des groupes alliés dans des conflits locaux, comme en Corée, au Vietnam ou en Afghanistan, pour étendre leur influence. En plus, ils ont utilisé la propagande et l’espionnage pour gagner en puissance et contrôler l’information. Cette confrontation indirecte a duré plusieurs décennies, jusqu’à la fin des années 1980.
Et que faisaient les pays européens pendant la guerre froide ?
Pendant la guerre froide, les pays européens étaient souvent divisés entre l’Est, sous influence soviétique, et l’Ouest, allié aux États-Unis. Les pays d’Europe de l’Ouest faisaient partie de l’OTAN, une alliance militaire pour se protéger contre l’URSS. Ceux de l’Est étaient dans le Pacte de Varsovie, contrôlé par l’Union soviétique. Beaucoup de pays européens ont vécu sous la menace d’un conflit nucléaire et ont dû s’adapter à cette division politique, économique et militaire pendant plusieurs décennies.
Pourquoi la guerre froide s'est t-elle terminée ?
La guerre froide s’est terminée à la fin des années 1980 et au début des années 1990 parce que l’Union soviétique a connu de grandes difficultés économiques et politiques. Les réformes lancées par Mikhaïl Gorbatchev, comme la « perestroïka » (réorganisation) et la « glasnost » (transparence), ont ouvert la porte à plus de liberté et à la fin du contrôle strict du gouvernement. En même temps, les pays d’Europe de l’Est ont commencé à se libérer du pouvoir soviétique. Finalement, l’URSS s’est effondrée en 1991, ce qui a marqué la fin de la guerre froide.
Est-ce que tout le monde étaient du coté américain ou russe ?
Non, tout le monde n’était pas forcément du côté américain ou russe pendant la guerre froide. Certains pays ont choisi de s’allier avec les États-Unis ou l’URSS, mais d’autres ont préféré rester neutres ou créer un « mouvement des non-alignés » pour ne pas prendre parti. Ces pays voulaient garder leur indépendance et éviter d’être impliqués dans cette rivalité entre les deux superpuissances.
Est-ce que la guerre froide a encore des conséquences aujourd'hui ?
Oui, la guerre froide a encore des conséquences aujourd’hui. Beaucoup des tensions et rivalités commencées à cette époque existent toujours entre certains pays, comme entre les États-Unis et la Russie. La division de l’Europe en Est et Ouest a laissé des traces politiques, économiques et sociales. Des organisations créées pendant la guerre froide, comme l’OTAN, jouent toujours un rôle important. Enfin, les armes nucléaires et la peur d’un conflit mondial restent des questions majeures liées à cette période.
Est ce que la guerre en Ukraine est le début d'une deuxième guerre froide ?
Beaucoup de gens se demandent si la guerre en Ukraine pourrait marquer le début d’une « deuxième guerre froide ». Cette guerre a clairement ravivé les tensions entre la Russie et les pays occidentaux, surtout les États-Unis et l’Europe, qui soutiennent l’Ukraine. Comme pendant la guerre froide, il y a des rivalités politiques, économiques, et militaires, avec des sanctions, de la propagande, et un soutien aux camps opposés. Mais la situation est aussi différente, car le monde est plus connecté aujourd’hui, avec d’autres puissances importantes comme la Chine. Donc, certains parlent d’une nouvelle forme de guerre froide, mais ce n’est pas exactement la même chose qu’avant.
Quel a été le rôle de la résistance pendant la seconde guerre mondiale ?
La résistance pendant la Seconde Guerre mondiale a joué un rôle très important. Ce sont des groupes de personnes, souvent des civils, qui se sont battus contre l’occupation allemande et les régimes nazis dans leurs pays. Ils faisaient des actions comme saboter les infrastructures, recueillir des informations pour les Alliés, aider les prisonniers et les juifs à s’échapper, et organiser des combats. Leur combat a aidé à affaiblir les forces ennemies et a montré que tous les peuples n’acceptaient pas la domination nazie. La résistance a aussi préparé la libération et marqué l’histoire de la lutte pour la liberté.
Est-ce qu'il y a eu des résistants allemands ?
Oui, il y a eu des résistants allemands. Même si la plupart des Allemands soutenaient ou étaient soumis au régime nazi, certains ont refusé cette dictature et ont agi en secret pour s’opposer à Hitler. Ces résistants ont mené des actions comme distribuer des tracts, aider des victimes, ou préparer des complots pour tuer Hitler, comme celui du 20 juillet 1944. Leur courage était important, même s’ils étaient souvent arrêtés et punis très sévèrement.
Pourquoi le maréchal Pétain a été mis au pouvoir ?
Le maréchal Pétain a été mis au pouvoir en 1940 parce que la France venait de subir une défaite rapide face à l’Allemagne nazie lors de la bataille de France. Le gouvernement français a voulu un leader expérimenté pour essayer de sauver ce qui restait du pays. Pétain, héros de la Première Guerre mondiale, a été choisi pour diriger un nouveau gouvernement à Vichy. Il a alors décidé de collaborer avec l’Allemagne pour essayer de protéger la France, mais cela a divisé le pays et a conduit à la résistance de nombreux Français.
Pourquoi De Gaulle est parti en Angleterre ?
De Gaulle est parti en Angleterre en 1940 parce qu’il refusait la défaite de la France et la collaboration avec l’Allemagne nazie. Depuis Londres, il a lancé un appel à continuer la lutte contre l’occupant allemand et à ne pas accepter la capitulation. Cet appel, diffusé le 18 juin 1940, a marqué le début de la résistance française depuis l’étranger, avec De Gaulle comme symbole de la France libre.
Après la fin de la seconde guerre mondiale, pourquoi De Gaulle a t-il dirigé le gouvernement provisoire ?
Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, De Gaulle a dirigé le gouvernement provisoire parce qu’il était reconnu comme le chef de la Résistance française et le symbole de la France libre. Il avait gagné beaucoup de légitimité grâce à son combat contre l’occupation allemande et à son rôle dans la libération du pays. Son gouvernement provisoire avait pour mission de reconstruire la France, rétablir la démocratie, et préparer les élections pour un nouveau régime politique.
Quelle a été la proportion de résistants et de collaborateurs dans la population française?
Pendant la Seconde Guerre mondiale, la majorité de la population française est restée passive, sans s'engager activement ni dans la Résistance ni dans la collaboration, souvent par peur, par prudence ou par nécessité. Seule une petite minorité, environ 1 à 2 % de la population, a participé activement à la Résistance, en menant des actions contre l’occupant, en aidant les persécutés ou en transmettant des informations. Une autre minorité, d'une taille similaire, a choisi de collaborer avec les nazis, en les aidant directement, en dénonçant des résistants ou en soutenant le régime de Vichy. Même si ces groupes étaient peu nombreux, leurs actions ont eu un impact majeur sur l’histoire de la France.
Qu'est t-il arrivé aux collaborateurs après la guerre ?
Après la guerre, les collaborateurs ont été punis lors d'une période appelée l’épuration. Certains ont été jugés par la justice pour avoir aidé les nazis : ils ont été condamnés à des peines de prison, à la déchéance de leurs droits civiques, ou même à mort dans les cas les plus graves. D’autres ont été punis sans procès, parfois de façon violente, par des résistants ou des citoyens en colère (ce qu’on appelle l’épuration sauvage). Des milliers de personnes ont ainsi été arrêtées, jugées ou sanctionnées, mais certains collaborateurs ont aussi échappé à la justice.
Comment est-ce que la IVe république a été mise en place ?
La IVe République a été mise en place après la Seconde Guerre mondiale, en 1946. Après la Libération, le gouvernement provisoire dirigé par De Gaulle a organisé des élections pour redonner la parole au peuple. Une Assemblée constituante a été élue pour écrire une nouvelle Constitution. La première version a été rejetée par référendum, mais une deuxième a été acceptée par les Français. La IVe République est donc née officiellement en octobre 1946. Elle voulait rétablir la démocratie et reconstruire le pays, mais elle a eu des difficultés politiques à cause de l’instabilité des gouvernements.
Pourquoi la IVe république était instable ?
La IVe République était instable parce qu’il y avait trop de partis politiques et aucun ne réussissait à avoir une majorité solide à lui seul. Les gouvernements devaient donc former des coalitions (alliances entre partis), mais ces alliances étaient souvent fragiles et se disputaient rapidement. Résultat : les gouvernements changeaient très souvent (presque un par an), ce qui rendait les décisions difficiles à prendre, surtout face à des crises comme la guerre d’Indochine ou la guerre d’Algérie. Cette instabilité a fini par affaiblir le régime et a préparé l’arrivée de la Ve République.
Qui a fait la constitution de la Ve république ?
La Constitution de la Ve République a été rédigée en 1958 par une équipe dirigée par Charles de Gaulle, avec l’aide du juriste Michel Debré, qui en a été le principal auteur. De Gaulle voulait un régime plus stable, avec un président fort, pour éviter les problèmes de la IVe République. La nouvelle Constitution a été approuvée par référendum par une large majorité des Français et elle est toujours en vigueur aujourd’hui, même si elle a été modifiée plusieurs fois.
Pourquoi De Gaulle est revenu ?
De Gaulle est revenu au pouvoir en 1958 parce que la France traversait une grave crise à cause de la guerre d’Algérie et de l’instabilité politique de la IVe République. Le gouvernement ne parvenait plus à gérer la situation, et certains craignaient même un coup d’État militaire. De Gaulle, respecté pour son rôle pendant la Seconde Guerre mondiale, est apparu comme le seul capable de rétablir l’ordre. Il a été appelé par le président de la République et a accepté de revenir, à condition de pouvoir changer la Constitution. C’est ainsi qu’il a fondé la Ve République.
Pourquoi la France a t-elle connu une décolonisation ?
La France a connu une décolonisation après la Seconde Guerre mondiale parce que de plus en plus de peuples colonisés voulaient devenir indépendants. La guerre avait affaibli la France, et les colonies ne voulaient plus être dominées. Elles réclamaient leur liberté, parfois par la négociation, parfois par des luttes armées, comme en Indochine ou en Algérie. En plus, le monde changeait : les États-Unis et l’URSS, les deux grandes puissances, soutenaient l’indépendance des peuples, et l’ONU aussi. La France a donc dû peu à peu accorder l’indépendance à ses colonies, même si cela a parfois été long et violent.
Pourquoi la guerre d'Algérie a t-elle été différente ?
La guerre d’Algérie a été différente des autres décolonisations parce qu’elle a été très violente, longue (de 1954 à 1962), et qu’il ne s’agissait pas seulement d’une colonie classique : l’Algérie était considérée comme une partie intégrante de la France. Il y avait aussi beaucoup de Français d’origine européenne (les pieds-noirs) qui vivaient en Algérie et refusaient l’indépendance. Des attentats, des tortures, des massacres ont été commis des deux côtés. Cette guerre a profondément divisé la société française et provoqué une grave crise politique, qui a conduit au retour de De Gaulle et à la naissance de la Ve République.
Comment s'est passé le rapatriement des Français d'Algérie ?
Le rapatriement des Français d’Algérie, appelés les « Pieds-noirs », s’est déroulé surtout entre 1962 et 1964, après la fin de la guerre d’Algérie et l’indépendance du pays. Beaucoup ont dû quitter l’Algérie rapidement, souvent dans des conditions difficiles, car ils ne se sentaient plus en sécurité ou étaient expulsés. Ils sont arrivés en France métropolitaine où ils ont parfois été mal accueillis et ont eu du mal à s’intégrer, car il y avait un grand nombre d’arrivants en peu de temps. Ce rapatriement a été un moment douloureux, marqué par la nostalgie de leur ancienne vie en Algérie et les tensions liées à la guerre.
Pourquoi y a t-il eut des vagues de migration en France alors qu'il y a eut des décolonisations ?
Après les décolonisations, plusieurs vagues de migration vers la France ont eu lieu pour plusieurs raisons. D’abord, beaucoup d’anciens habitants des colonies, comme les Algériens, les Marocains ou les Tunisiens, sont venus en France pour chercher du travail, car la France avait besoin de main-d’œuvre pour reconstruire le pays après la guerre. Ensuite, certains migrants fuyaient les conflits ou les difficultés économiques dans leurs pays nouvellement indépendants. Enfin, il y avait aussi des Français d’origine européenne (les pieds-noirs) et des harkis (Algériens qui avaient combattu aux côtés de la France) qui sont venus s’installer en France après la guerre d’Algérie, souvent dans des conditions difficiles.
C'est quoi les trente glorieuses ?
Les Trente Glorieuses désignent la période de 30 ans, de 1945 à 1975 environ, pendant laquelle la France (et aussi d’autres pays d’Europe) a connu une forte croissance économique, beaucoup de progrès social, et une amélioration générale du niveau de vie. C’était une époque de reconstruction après la guerre, avec beaucoup d’emplois, d’industries qui se développent, et la naissance de la société de consommation. Les Trente Glorieuses ont permis à beaucoup de Français d’avoir une meilleure maison, une voiture, la télévision, et plus de confort.
Pourquoi y a t-il eut des révoltes en mai 68 ?
Les révoltes de mai 68 en France ont commencé parce que beaucoup de jeunes, surtout des étudiants, étaient mécontents. Ils trouvaient que la société était trop autoritaire, que l’université ne répondait pas à leurs besoins, et qu’il n’y avait pas assez de liberté. Le mouvement s’est ensuite étendu aux ouvriers, qui réclamaient de meilleurs salaires et de meilleures conditions de travail. Pendant plusieurs semaines, il y a eu des grèves massives, des manifestations et des blocages dans tout le pays. Mai 68 a été un grand moment de contestation contre le pouvoir, les règles traditionnelles, et pour plus de liberté et de justice sociale.
Pourquoi De Gaulle est parti après mai 68 ?
De Gaulle est parti après mai 68 parce que, malgré sa popularité, il a perdu une partie importante du soutien politique. Les manifestations et les grèves massives ont montré que beaucoup de Français étaient mécontents, y compris certains membres de son propre gouvernement et de l’armée. En mai 1968, il a d’abord tenté de reprendre le contrôle en dissolvant l’Assemblée nationale et en appelant à de nouvelles élections, qu’il a remportées largement. Mais en avril 1969, il a organisé un référendum pour réformer le Sénat et régionaliser la France. Quand les Français ont rejeté ce projet, De Gaulle a décidé de démissionner, estimant qu’il n’avait plus la confiance nécessaire pour diriger le pays.
Pourquoi Giscard D'Estaing était différent des autres présidents ?
Giscard d’Estaing était différent des autres présidents parce qu’il voulait moderniser la France et la rendre plus ouverte. Il a promu des réformes sociales importantes, comme abaisser la majorité à 18 ans, légaliser l’avortement, et améliorer les droits des femmes. Il a aussi cherché à rapprocher la France des autres pays européens en renforçant l’Union européenne. Contrairement à ses prédécesseurs, il avait un style plus décontracté et accessible, ce qui a changé l’image de la présidence.
Pourquoi on dit que Mitterrand c'était un changement ?
On dit que Mitterrand représentait un changement parce qu’en 1981, il est devenu le premier président socialiste de la Ve République. Il a lancé plusieurs réformes importantes pour améliorer la vie des Français : il a augmenté le salaire minimum, instauré la retraite à 60 ans, aboli la peine de mort, et développé les services publics. Son élection a marqué une nouvelle direction politique après longtemps de présidents de droite ou du centre. Mitterrand a aussi fait évoluer la France vers plus de justice sociale et a donné une voix plus forte à la gauche.
Et pourquoi on dit "qu'il a trahi" la gauche ?
On dit que Mitterrand a « trahi » la gauche parce qu’après ses premières réformes très à gauche dans les années 1981-1983, il a dû changer de politique à cause des difficultés économiques. Face à la crise, il a adopté des mesures plus libérales, comme réduire les dépenses publiques et freiner les augmentations sociales, ce qui a déçu beaucoup de ses soutiens à gauche. Ce tournant, appelé le « tournant de la rigueur », a été vu par certains comme un abandon des idéaux socialistes, d’où l’idée qu’il aurait trahi la gauche.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repères chronologiques – Histoire Troisième
(XXᵉ – début XXIᵉ siècles)
Première Guerre mondiale (1914 – 1918)
- 28 juin 1914 : assassinat de François‑Ferdinand (Sarajevo)
- Août 1914 : mobilisation générale et début du conflit
- 1915 -16: génocide arménien par l’Empire ottoman
- 1916 : batailles de Verdun et de la Somme
- Avril 1917 : entrée en guerre des États‑Unis
- Octobre 1917 : Révolution bolchevique en Russie
- 11 novembre 1918 : armistice de Rethondes
- 1919‑1920 : traité de Versailles et création de la SDN
L’entre‑deux‑guerres (1919 – 1939)
- 1922 : Marche sur Rome ; Mussolini au pouvoir (Italie)
- 1923 : putsch manqué d’Hitler à Munich
- 1924‑1953 : Staline dirige l’URSS
- 1929 : krach de Wall Street → Grande Dépression mondiale
- 1933 : Hitler chancelier ; début du IIIᵉ Reich
- 1934 : « Nuit des Longs Couteaux » (Allemagne)
- 1935 : lois de Nuremberg (antisémites)
- 1936‑1939 : guerre d’Espagne
- 1936 : Front populaire en France (congés payés, 40 h)
- 1938 : Anschluss (annexion de l’Autriche) puis accords de Munich
- 23 août 1939 : pacte germano‑soviétique
Seconde Guerre mondiale (1939 – 1945)
- 1ᵉʳ septembre 1939 : invasion de la Pologne → guerre
- 10 mai 1940 : offensive allemande à l’Ouest
- 18 juin 1940 : appel du général de Gaulle
- 22 juin 1940 : armistice franco‑allemand
- Juin 1941 : opération Barbarossa (attaque de l’URSS)
- Décembre 1941 : attaque japonaise de Pearl Harbor
- 1942 : rafle du Vel’ d’Hiv (France)
- Févr. 1943 : capitulation allemande à Stalingrad
- 1943 : création du CNR (France)
- 6 juin 1944 : débarquement allié en Normandie
- 25 août 1944 : libération de Paris
- 8 mai 1945 : capitulation de l’Allemagne
- 6 & 9 août 1945 : bombes sur Hiroshima et Nagasaki
- 2 septembre 1945 : capitulation japonaise ; fin du conflit mondial
- 1945‑1946 : procès de Nuremberg
Guerre froide (1947 – 1991)
- 1946 : discours du « rideau de fer » (Churchill)
- 1947 : doctrine Truman & plan Marshall
- 1948‑49 : blocus et pont aérien de Berlin
- 1949 : création de l’OTAN ; proclamation RFA & RDA
- 1950‑53 : guerre de Corée
- 1953 : mort de Staline
- 1955 : pacte de Varsovie
- 1957 : Spoutnik ; début de la conquête spatiale
- 1961 : construction du mur de Berlin ; vol de Youri Gagarine
- 1962 : crise des missiles de Cuba
- 1964‑75 : guerre du Viêt Nam (implication US)
- 1969 : premiers pas sur la Lune (Armstrong, Apollo 11)
- 1973 : premier choc pétrolier
- 1975 : fin guerre du Viêt Nam
- 1979 : révolution iranienne ; invasion soviétique de l’Afghanistan
- 1980 : mouvement Solidarność (Pologne - debut des contestations contre l'URSS)
- 1985 : Gorbatchev lance Perestroïka & Glasnost
- 1986 : catastrophe de Tchernobyl
- 1989 : chute du mur de Berlin ; révolutions de l’Est
- 1990 : réunification allemande
- 1991 : dislocation de l’URSS ; fin officielle de la Guerre froide
Décolonisation (1945 – 1975)
- 1947 : indépendance de l’Inde & du Pakistan
- 1948 : création de l’État d’Israël
- 1954 : bataille de Diên Biên Phu & accords de Genève (Indochine)
- 1956 : indépendance du Maroc & de la Tunisie
- 1957 : indépendance du Ghana (1ʳᵉ en AOF)
- 1960 : « année de l’Afrique » (17 indépendances)
- 1962 : accords d’Évian → indépendance de l’Algérie
Construction européenne
- 1951 : CECA (Schuman, Monnet)
- 1957 : traité de Rome → CEE
- 1973 : 1ᵉʳ élargissement (R.-U., Irlande, Danemark)
- 1986 : Acte unique européen
- 1992 : traité de Maastricht → Union européenne
- 1999 : adoption de l’euro
- 2002 : mise en circulation des billets & pièces euro
- 2004 : élargissement à 10 PECO
- 2007 : traité de Lisbonne
- 2016 : Brexit voté au Royaume‑Uni (sortie 2020)
France depuis 1945
- 1946 : constitution de la IVᵉ République
- 1958 : naissance de la Vᵉ République (de Gaulle)
- 1965 : Autorisation de la pillule contraceptive
- 1968 : événements de Mai 68
- 1975 : loi Veil dépénalisant l’IVG
- 1981 : Mitterrand président ; abolition de la peine de mort
- 1995 : Chirac président
- 2005 : révolte des banlieues françaises
- 2015 : attentats de Charlie Hebdo & du Bataclan
- 2023 : contestation de la réforme des retraites
Grandes dates mondiales contemporaines
- 1945 : création de l’ONU
- 1948 : Déclaration universelle des droits de l’homme
- 1955 : boycott de Montgomery (Rosa Parks)
- 1963 : discours « I have a dream » (M. L. King)
- 1964 : Civil Rights Act (USA)
- 1967 : guerre des Six Jours (M.-Orient)
- 1968 : assassinat de Martin Luther King & Robert Kennedy
- 1991 : guerre du Golfe (opération Tempête du Désert)
- 1994 : génocide des Tutsis au Rwanda
- 1995 : accords de Dayton (fin guerre Bosnie)
- 2001 : attentats du 11 septembre (USA)
- 2003 : invasion de l’Irak
- 2007 : lancement du premier iPhone
- 2008 : crise financière mondiale (chute de Lehman Brothers)
- 2010‑12 : « Printemps arabes »
- 2011 : catastrophe de Fukushima
- 2014 : annexion de la Crimée par la Russie
- 2016 : accord de Paris sur le climat (COP 21)
- 2020 : début de la pandémie mondiale de Covid‑19
- 2022 : invasion de l’Ukraine par la Russie
- 2023 : séisme en Turquie‑Syrie ; intelligence artificielle générative en plein essor
Culture, sport & société
- 1930 : première Coupe du monde de football (Uruguay)
- 1969 : festival de Woodstock
- 1977 : sortie du premier film Star Wars
- 1992 : JO d’Albertville (France)
- 1998 : France championne du monde de football
- 2004 : lancement de Facebook
- 2016 : JO de Rio ; première médaille d’or olympique pour un athlète réfugié (équipe EOR)
- 2024 : Jeux olympiques de Paris
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------